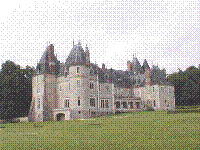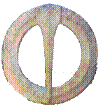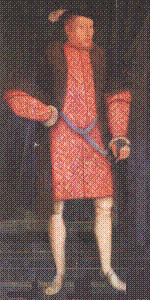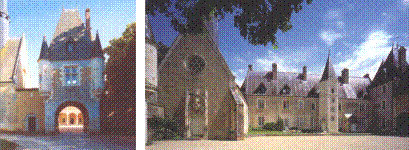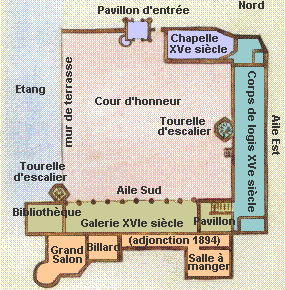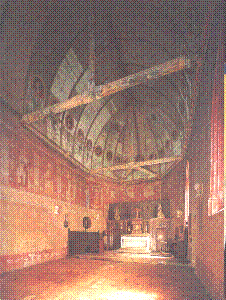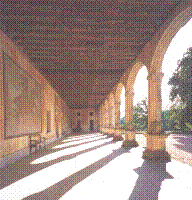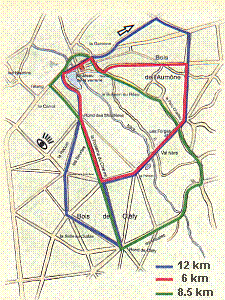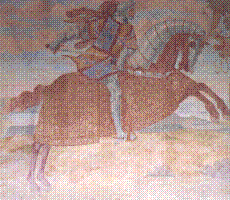- "je tenais à trouver pour nos enfants un coin de sol sur lequel pussent se reposer la souvenirs de leur imagination de jeunesse et l'affection locale du foyer paternel. Ce lieu traduit parfaitement ce thème de mon coeur et de ma sollicitude."
L. de Vogüé, novembre 1849
- Une famille vivaroise en terre berrichonne : Les Vogüe
"Hier, je me suis dirigé au galop, à travers mes bois d'lvoy, vers le vieux château d'Aubigny ; le temps était charmant, le soleil égayait le site sauvage, la vieille tour se réfléchissait dans l'étang. Il y avait je ne sais quoi d'engageant dans l'aspect du paysage. La chapelle était ouverte et ornée ; le curé m'a écrit le matin une lettre en style biblique pour m'engager à protéger de la destruction cette sainte demeure."
C'est en ces termes que Léonce de Vogüé écrit à sa femme le lendemain de son acquisition du domaine auprès des marchands de biens parisiens. Désormais, le château de La Verrerie va revivre.
Jeune descendant d'une vieille famille vivaroise, Léonce-Louis-Melchior de Vogüé est né à Paris. Fils de Charles de Vogüé et de Zéphirine de Damas, petit-fils, par celle-ci, du duc Charles de Damas et d'Aglaé de Langeron, arrière-petit-fils, par cette dernière, du marquis de Langeron et de Marie-Louise Perrinet du Peseau, Léonce de Vogüé, d'abord destiné à une carrière militaire - il entre à seize ans au Corps des Pages du Roi à Versailles - devient héritier des grandes propriétés de la famille Perrinet en Sancerrois et en Pays Fort.
Après sa participation aux campagnes d'Espagne (1823) et d'Algérie (1830), il démissionne de l'armée pour retrouver sa femme, Henriette de Machaut d'Arnouville, en Berry. Dès l'automne 1834, il acquiert les propriétés d'lvoy, voisines de Boucart, comprenant 3 000 arpents de bois et une forge.
- La Verrerie, demeure familiale
C'est Louis qui décide de faire du château de La Verrerie une maison familiale confortable qui accueillera les nombreux enfants qu'il souhaite avoir de son union avec Louise d'Arenberg ; leurs neuf enfants rempliront de leurs rires les pièces de la vieille bâtisse. Depuis cette époque date l'idée de travaux incessants pour accommoder au confort moderne le château des Stuart.
Pour l'heure, La verrerie est inhabitable sans de gros travaux. Le couple voit grand : il veut un salon, un deuxième salon pour le billard, une grande salle à manger, une petite pour les enfants, un office, une vaste cuisine, un garde-manger, une pièce à chaussures sans compter d'innombrables pièces à coucher et quelques salles de bains. Plutôt que de s'accommoder des bâtiments existants, l'architecte Sanson préconise une nouvelle aile composée d'une galerie intérieure flanquée de deux excroissances avec tours pointues. En sus, des gargouilles pour faire bonne mesure.
Reste à trouver le financement de tels travaux. Les dépenses du couple sont réduites au strict minimum. Bientôt, le gros oeuvre de l'aile Sud débute, alors que les intérieurs de l'aile Est retrouvent lentement une nouvelle jeunesse, parés de nouveaux tissus, meubles, tapis persans et autres bimbeloteries à la mode...
Après la Seconde Guerre mondiale, il convient de s'organiser différemment : la famille ne peut plus s'accommoder de rares passages au château de La Verrerie. Il faut qu'un des membres de la famille s'y installe de façon permanente pour le restaurer et l'entretenir.
Antoine, fils de Melchior et père de Béraud, l'actuel propriétaire, suit alors les cours de l'Ecole Agricole d'Angers pour reprendre le domaine familial et en assurer la gestion. A la mort de sa mère Louise en 1956, il occupe le château et commence d'effectuer, avec sa femme Françoise de Hautecloque, d'indispensables travaux de consolidation et d'aménagement aboutissant à une ouverture au public en 1960.
- Léonce L.M., marquis de Vogüé (1805-1877). Un homme de terrain
De nombreuses expériences agricoles le mènent à l'Académie d'agriculture. Il s'illustre aussi dans le domaine métallurgique, en fondant, en 1846, l'usine de Mazières, près de Bourges.
Il devient conseiller général du Cher en 1839, et préside le Conseil en 1849 après avoir été élu député à l'assemblée Constituante de 1848. Très sollicité, grand chasseur et grand voyageur, il n'en trouve pas moins le temps de fonder la revue Le Correspondant avec son ami E. Cazales (1829). Il acquiert les châteaux de Vogüé et de Rochecolombe (1840) dont son grand-père avait été dépossédé, sauvant le premier édifice (1843) de la ruine et y installant une école tenue par la congrégation de Saint Joseph d'Aubenas, qui en assurera la marche jusqu'en 1860.
- Le souvenir de Robert de Vogüé (1835-1870)
frère de Léonce de Vogüé, Robert trouvera la mort lors d'une attaque menée par le Maréchal de MacMahon en personne, à la tête de cinq bataillons d'infanterie à la bataille de Reichshoffen, le 6 août 1870. Son père lui avait remis le sabre qu'il avait lui-même porté en Espagne et en Algérie. un officier prussien le ramassa sur le champ de bataille et eut la courtoisie de le rendre à la famille.
- £ugène-Melchior, vicomte de Vogüé (1848-1910). L'écrivain
Ayant passé sa jeunesse au château de Gourdan, près d'Annonay, Eugène-Melchior, arrière-petit-cousin de Charles-Melchior, ambassadeur et académicien, est engagé volontaire en 1870 et blessé à la bataille de Sedan.
A la faveur d'un début dans la vie diplomatique, ses talents littéraires se révèlent au contact de l'orient (Turquie, Egypte, Palestine) puis de la Russie. Il publie en 1886 son oeuvre principale, Le Roman Russe. En révélant à l'opinion française les richesses intellectuelles et spirituelles de la Russie, ce livre marque une date importante dans l'histoire littéraire et politique de la fin du XIXe siècle ; il contribue à l'élection de son auteur à l'Académie française.
Collaborateur régulier de la Revue des Deux Mondes et du Journal des Débat, il influence le rapprochement de Léonon XIII avec la Troisième république, favorise le mouvement du catholicisme social, les initiatives françaises aux colonies.
Eugène-Melchior de Vogüé s'illustre également par son oeuvre de romancier (Jean d'Agrève, Le Maître de la Mer, Les Morts qui parlent). Il fut par ailleurs député de l'Ardèche entre 1893 et 1898.
- Louis, marquis de Vogüé (1868-1948). L'homme de la terre
Louis de Vogüé, petit-fils de Léonce et fils de Charles-Melchior ambassadeur et académicien, fait partie de ce groupe d'individus désintéressés qui, sous l'efficace influence d'Albert de Mun et de La Tour du Pin, fonde en France, à la fin du XIXe siècle, les institutions professionnelles et de prévoyance du monde agricole.
Son action le mène à la présidence de l'Union Centrale des syndicats agricoles et de la société des Agriculteurs de France qu'il assure de 1919 à 1948.
Elu à l'Académie d'Agriculture en 1919, il succède en 1924 à Jules Méline comme président de la confédération internationale de l'agriculture.
Cette activité syndicale s'accompagne aussi d'une importante activité économique et diplomatique : il sera un temps le président de la Compagnie du Canal de Suez et régent de la Banque de France. Il accorde aussi un peu de son temps à des oeuvres de charité, présidant entre autres la Société Philanthropique.
Commandeur de la Légion d'Honneur, il est maire d'Oizon de 1900 à 1929 et conseiller général du Cher de 1911 à 1945.
- C.-J. Melchior, marquis de Vogüé (1829-1916). L'archéologue
Après avoir préparé l'école de Saint-Cyr et l'Ecole de Polytechnique, Melchior de Vogüé s'engage dès sa jeunesse dans une carrière d'archéologue et d'historien.
A la suite de nombreuses expéditions au Moyen-Orient, il publie des ouvrages d'archéologie sur Les églises de Terre Sainte (1860), Le Temple de Jérusalem (1864), ou La Syrie Centrale (1865-1868 et 1877) où il évoque "l'état des ruines, leur solitude, le vaste désert qui les environne".
De même que l'ampleur de ses études archéologiques le conduit à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres en 1868, ses travaux historiques, mais aussi ses nombreuses oeuvres précédentes, lui ouvrent les portes de l'Académie Française où il est élu en 1901.
Appelé à la vie politique par Thiers, puis par Mac-Mahon, Melchior est nommé ambassadeur à Constantinople (1871-1875) puis à Vienne (1875-1879), tout en assurant la présidence, à partir de 1877, de la revue Le Correspondant. Poursuivant, avec soin, les travaux d'exploitation agricole de son père, il préside aussi la Société des Agriculteurs de France à partir de 1896. Souhaitant jouer un rôle social important, il est bientôt le président de la Société de secours aux blessés militaires (1904), puis, de la Croix Rouge Française (1907).
La dernière partie de sa vie est aussi magnifiquement remplie. Il l'évoque en ces termes : "jamais je n'ai tant travaillé, ni si bien supporté le travail".
En 1901, on le désigne pour lui confier la présidence de la Compagnie des Glaces et Produits chimiques de Saint-Gobain, dont il était membre du Conseil d'administration depuis huit ans.
Ses attaches berrichonnes (il est conseiller général de Léré de 1871 à 1904) ne l'empêchent aucunement de consacrer la fin de sa vie à l'histoire du Vivarais, en relation avec sa famille, dont il publie une monographie en 1906, Une famille Vivaroise.
- Melchior, marquis de Vogüé (1893-1965). De la finance à la clôture
- Après son mariage avec Geneviève Brincard, petite-fille d'Henri Germain, fondateur du Crédit Lyonnais, il devient l'administrateur de l'établissement de 1935 à 1955.
Maire de Oizon de 1929 à 1953, il quitte avec son épouse toutes ses activités familiales et professionnelles pour se consacrer à Dieu : il est ordonné prêtre en 1961 au monastère bénédictin de la Pierre-qui-Vire. sa femme, qui a fait ses voeux perpétuels au monastère de Limon, est ensevelie auprès de lui à la Pierre-qui-Vire, en 1974.
VETERA NOVIS AUGERE
"j'ai aimé la vérité, la justice et la liberté dans l'ordre ; j'ai beaucoup souffert des outrages qu'elles reçoivent chaque jour. j'ai aimé l'étude ; je lui dois des heures heureuses et une assistance efficace dans les épreuves de la vie. J'ai aimé passionnément mon pays et j'aurai voulu pouvoir le servir plus utilement ; les circonstances ne l'ont pas permis et j'ai assisté impuissant au naufrage des causes que j'ai essayé de servir. Je souhaite à mes enfants des circonstances plus favorables ; j'espère qu'ils pourront en profiter en s'inspirant de nos traditions de famille et en les adaptant aux besoins nouveaux" écrit Melchior de Vogüé dans son testament.
La maxime VETERA NOVIS AUGERE exprimée dans la dernière phrase, sera reprise par ses descendants.
- Antoine J.-M., comte de Vogüé (1923-1998). Un homme engagé et dévoué
Durant la Seconde guerre mondiale, il entre dans la Résistance sous les ordres de son oncle le colonel Colomb (Arnaud de Vogüé). Au sortir du conflit, il crée la coopérative forestière du Centre, l'une des plus importantes de France, et devient maire d'Oizon, il le sera pendant 45 ans.
Parallèlement, il siège au Conseil général du Cher (34 ans), où il sera notamment vice-président, et participe activement au développement du tourisme dans ce département.
- Françoise de Hautecloque. L'inébranlable volonté de faire vivre une demeure familiale et historique
Lorsque la nièce du Maréchal Leclerc entreprend avec son mari la restauration et l'embellissement de La verrerie, le logis Est du château est occupé par de nombreuses pièces secondaires : logis du cuisinier, dépôt de bois, sacristie-lingerie, pièce frigorifique, pièce à chaussures et grande cuisine s'y succèdent le long d'un grand couloir.
En quelques décennies, les pièces changent d'attributions, se recomposent pour retrouver un éclat, comme en témoigne la cheminée ornée des armoiries des Stuart, un des rares éléments anciens non détruit par les Richmond vers 1830.
En 1978, elle décide de lancer un restaurant dans la petite maison qui fait face au pavillon du château. Grillades, mais aussi de succulentes terrines et autres salades légères remportent un franc succès.
Deux ans plus tard, une dizaine de chambres du château - de belles suites pour certaines - sont prêtes à accueillir leur première clientèle française et étrangère pour quelques moments de bonheur, dans un cadre idyllique et préservé.
- Béraud, comte de Vogüé. Premier propriétaire né à La Verrerie
- Après une enfance passée dans le Cher, et des études de droit à Paris, il part en Amérique du Nord où il passe près de 15 ans. De retour à La Verrerie à la demande de son père Antoine, il entreprend avec sa femme, Diane Paul-Boncour de développer l'activité touristique de la demeure de famille, berceau de son enfance.
Les rendez-vous de Louise d'Arenberg
Béraud de Vogüé a conservé quelques beaux souvenirs de sou arrière-grand-mère, Louise de Vogüé, née Princesse d'Arenberg.
Tous les jours que Dieu faisait, tous les petits-enfants et arrière-petits-enfants de la famille avaient obligation de visiter leur aïeule à heure fixe. Chaque matin, entre neuf et dix heures, elle accordait quelques minutes, écoutant, conseillant, réprimandant, et prodiguant à chacun sa sagesse et son expérience. Suivaient ensuite le maître d'hôtel, veillant à l'organisation du jour, et le courrier.
A seize heures, et par tous les temps - "on n'échange pas ses projets à cause du temps" précisait-elle souvent - elle faisait une promenade sur le domaine avant de rentrer pour le thé, à dix-sept heures.
- Béraud de Vogüé. La chasse, un plaisir vivace
Stuart, Lennox et Richmond s'adonnaient sans déplaisir à la chasse. L'arrivée de la famille de Vogüé en terre berrichonne n'aura pas bouleversé une tradition séculaire. Charles, l'un des fils de Léonce de Vogüé, est sans doute le premier à disposer d'un équipage à La Verrerie. De cette époque datent les relations d'excellent voisinage avec les équipages locaux qui parcourent, la saison venue, les domaines de La Verrerie.
Dans les années 1950-1960, du temps de la marquise de Cossé-Brissac, née princesse d'Arenberg, l'équipage Vouzeron-Sologne sillonne la forêt. Béraud, actuel propriétaire du château, y fait ses premières armes à côté de son père, Antoine de Vogüé. Il acquiert ses six premiers chiens basset en 1972, puis des harriers qui lui permettent de s'adonner à sa vraie passion : la chasse au lièvre à pied.
En 1975, il fonde le Bouquin Berrichon, équipage auquel se joignent une bonne trentaine de passionnés désireux, comme lui, de ne pas vivre une chasse dénaturée par quelques rendez-vous mondains.
Aujourd'hui, une dizaine de membres de cette association cynégétique pratiquent la vénerie du lièvre, tous les dimanches à partir du mois de septembre.
Pourquoi le lièvre ? "Pour son intelligence, sa subtilité qui en font un animal difficile à prendre" avoue monsieur de Vogüé. "C'est une chasse où, plus que toute autre, la patience est capitale et, à mon goût, la communion avec la nature, totale".
"Elle permet aussi d'exprimer l'amour pour ces chiens de meutes dont je me suis entouré. Sûrement, ce n'est pas l'aspect flamboyant de cette chasse qui m'attire, mais plutôt sa difficulté", un gage d'authenticité...
|