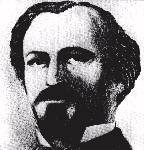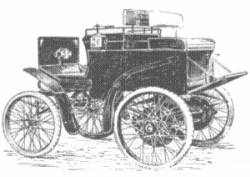HISTOIRE DE L'AUTOMOBILE - 1464 - 1899
(7023 marques, 11619 modèles et 1601 infos diverses)| sources |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1464 |
|---|
Louis XI crée la poste royale; relais toutes les 7 lieues (environ 28 km) |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1558 |
|---|
Pompe à palettes de l'ingénieur militaire italien RAMELLI (Gênes) ; pompe à 4 palettes radiales disposées à 90°, coulissant dans un rotor cylindrique excentré par rapport à un cylindre extérieur |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1627 |
|---|
Lettre patente autorisant l'exploitation commerciale de l'huile de pierre de Pechelbronn (La Fontaine de Poix), en Alsace ; l'huile de pierre, utilisée à des fins pharmaceutiques, est employée au XVIIIe siècle pour le graissage et le calfatage des bateaux ; Antar est créée en 1927 |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1636 |
|---|
Pompe à engrenages de l'allemand Pappenheim ; 2 engrenages de 6 dents chacun enveloppés d'un carter (suppression des parties coulissantes et non équilibrées de la pompe de Ramelli) ; machine tournant grâce à une roue à godets entraîné par l'eau d'une rivière (Alimentation de jets d'eau) ; privilège (équivalent des brevets actuels) accordé en 1636 par l'Empereur Ferdinand II |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1652 |
|---|
Moteur à poudre à vide relatif de Ch. et L. Huygens (NL, 1652-1688) |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1668 |
|---|
Moteur 2 temps à poudre de l'abbé Hautefeuille |
Première automobile : Modèle à vapeur de 60 cm de long de Ferdinand Verbiest (B), décrit dans Astronomia Europea |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1700 |
|---|
Au XVIIIe siècle, débuts de l'industrie du pétrole (Alsace, Ecosse, Roumanie, Espagne, Caucase) |
La découverte du gaz d'éclairage par William Murdock, au XVIIIe siècle, fait réfléchir les scientifiques sur la possibilité d'employer ce gaz inflammable à d'autres fins que l'éclairage des voies publiques. |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1707 |
|---|
Bateau à vapeur de Denis Papin |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1736 |
|---|
Charles-Marie de la Condamine (F) découvre le caoutchouc au Pérou |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1773 |
|---|
Le General Highways Act de 1773 recommande aux chevaux de circuler sur la gauche, disposition confirmée par le Highways Bill de 1835 |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1777 |
|---|
Pistolet puis canon de Volta |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1782 |
|---|
Machine à vapeur à piston oscillant de James Watt : une pale rorative en forme d'aile accomplit un mouvement de rotation presque complet en découvrant les lumières d'admission dans une chambre que séparait une paroi radiale cintrée |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1791 |
|---|
Un Anglais, John Barber, présente la description d'une turbine primitive, alimentée par un mélange d'air et d'huile de paraffine. |
Machines à vapeur d'essence de Robert Street (GB) |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1794 |
|---|
L'anglais Robert Sreet conçoit un moteur à gaz élémentaire fonctionnant selon un véritable cycle à deux temps |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1795 |
|---|
Projet de mélangeur-carburateur pour mélange alcool-thérébentine de Samuel Morey (USA) ; moteur vertical 2 temps en 1826 |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1799 |
|---|
Jusqu'à la fin du XIXe siècle, emploi majoritaire de graisses animales (suif) pour le graissage (machines à vapeur : saindoux, huile de colza) |
Description d'un moteur à gaz de houille par Philippe Lebon (F) ; cycle à 2 temps (brevet du 28 septembre 1799, additif du 28 août 1901) |
Machine à vapeur à piston tournant de William Murdoch (collaborateur de Watt) ; basée sur la pompe à engrenages de Pappenheim ; extrémité des dents des engrenages garnies d'une "lisse" en bois ; rendement très faible par manque d'étanchéïté et frottements importants |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1800 |
|---|
Napoléon premier crée la numérotation des routes en nationales et départementales |
Chariot à vapeur de Charles Dietz : 10 tonnes, chaudière tubulaire, pouvant entraîner un véritable train routier |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1801 |
|---|
Philippe Lebon, d'Humbersin, reconnu par les Français comme l'inventeur du gaz d'éclairage extrait de la houille, fait breveter un étrange moteur à gaz doté de trois cylindres de diamètres différents et d'un système primitif d'allumage par étincelle électrique ; Il meurt avant d'avoir pu exploiter cette invention. |
Locomotive routière "Traveling Engine" (Catch Who Can) de Richard Trevithick Jr, montée dans l'atelier de John Tyack (Camborne) avec l'aide d'Andrew Vivian et des ouvriers de Trevithick |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1804 |
|---|
J.B. Biot (F) : Principe de l'échauffement adiabatique des gaz par compression (Principe du moteur Diesel) |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1805 |
|---|
Machine à vapeur de Flint |
Moteur à air dilaté par la chaleur de N. et C. Niepce (F) ; principe du moteur Stirling, brevet du 3.4.1807 |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1807 |
|---|
Chariot à moteur vertical à 2 temps à piston libre d'Isaac de Rivaz, ex major de l'armée de la République helvétique du Valais ; brevet du 30.1.1807 "sur la manière d'utiliser la combustion des gaz inflammables pour mettre en mouvement diverses machines et remplacer la vapeur" |
De Rivaz commente ainsi sa découverte : "J'ai fait faire un cylindre de 6 pouces et demi de diamètre et d'un demi pied de longueur, en feuille de cuivre, bien alésé intérieurement. Dans ce cylindre pénètre exactement un piston, sous la forme d'un boulet, qui le rend étanche". Le principe du moteur de De Rivaz est extrêmement simple et l'analogie avec un boulet n'est pas fortuite car l'inventeur a conçu une sorte de canon vertical monté sur roues. Le gaz admis dans le cylindre est enflammé et projette alors le piston vers le haut du cylindre. La tige du piston est reliée par une chaîne et un rochet aux roues, et, au moment de l'ouverture d'un clapet qui laisse échapper les gaz brûlés, le piston retombe par son poids et entraîne les roues. Très curieusement, l'allumage est électrique et fonctionne au moyen d'une pile de Volta. Il semble que de Rivaz construisit réellement un chariot assez grossier, selon les données de son brevet, et tenta de le faire fonctionner chez lui. "La nécessité de remettre le chariot en position à la fin de chaque trajet me persuada de faire construire une pompe à incendie...". |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1808 |
|---|
Première démonstration de chemin de fer à Euston Square |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1817 |
|---|
Machine à vapeur de Poole |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1818 |
|---|
Appartition du vélocipède |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1819 |
|---|
Randonnée de Medhurst en machine à vapeur sur New Road entre Paddington et Lalington, d'avril à juin ; 5 mph puis 6 mph avec 10 personnes à bord |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1820 |
|---|
Utilisation d'un mélange air-hydrogène en enceinte close par C. Cambridge (GB) |
William Cecil, un clergyman britannique, fait fonctionner un petit modèle de moteur à gaz devant la Cambridge Philosophical Society. ; alimenté à l'hydrogène, il ressemble dans son principe aux machines à vapeur primitives et atteint le médiocre régime de 16 tours par minute ; son inventeur propose comme carburants de remplacement le gaz d'éclairage, le pétrole vaporisé, la térébenthine ou l'alcool ; s'il n'applique son moteur à aucun usage intéressant sinon le pompage de l'eau, Cecil attire l'attention de tous ceux qui commencent à expérimenter des formules de véhicules routiers vers le moteur à gaz |
David Gordon propose que la propulsion des véhicules soit assurée par du gaz de houille comprimé, livré en bouteilles sous pression dans des stations de ravitaillement disséminées dans le pays, mais il abandonne son idée après avoir calculé le coût exorbitant d'un tel système. |
Diligences à vapeur Gordon, Griffith et Gurney |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1823 |
|---|
Premiers énoncés de base de la thermodynamique par Léonard Sadi Carnot ; complétés par Clausius en 1875 |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1824 |
|---|
Samuel Brown, de Brompton, commence ses essais d'un moteur à gaz et "à vide" |
Voiture à vapeur à 4 roues motrices de Burstall et Hilk |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1825 |
|---|
Machine à vapeur de Wright |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1826 |
|---|
Moteur vertical 2 temps de Samuel Morey (USA) |
Samuel Brown installe une version perfectionnée de son moteur, dont les deux cylindres sont connectés par un balancier oscillant, dans un chariot à quatre roues ; brevet 5350 du 25.04, véhicule à moteur 4.05 CV, 2 cyl de 88 litres à gaz atmosphérique (mélange air-hydrogène) ; lors des essais sur route, au mois de mai 1826, il fait l'ascension de la côte de Shooters Hill près de Woolwich, "au grand étonnement des nombreux spectateurs", mais, une fois de plus, le coût de fonctionnement est la pierre d'achoppement, et Brown doit se tourner vers l'application de son moteur à la traction des bateaux sur les canaux ; après avoir construit un navire à roues qui navigue sur la Tamise, Brown trouve que, sur l'eau également, le moteur à gaz est trop coûteux |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1827 |
|---|
Brevet d'Onésiphore Pecqueur pour un différentiel sur les machines à vapeur |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1829 |
|---|
Brevet d'un chariot à vapeur destiné à circuler sur route par Onésiphore Pecqueur (chef des ateliers du Conservatoire des Arts et Métiers), contenant "la plupart des organes propres à en faire un bon véhicule automoteur" ; le moteur attaque les roues postérieures par l'intermédiaire d'un différentiel dont l'invention revient entièrement à Pecqueur ; l'avant-train directeur n'a pas de corps d'essieu, chacune des roues antérieures étant maintenue par une fourche verticale que prolonge un pivot articulé sur le châssis du chariot ; les deux pivot sont reliés à leur partie supérieure par une traverse horizontale, à laquelle le châssis est suspendue par des ressorts ; pivots conjuguées dans leur rotation par un système de deux leviers de direction et d'une barre d'accouplement, de façon que les plans des deux roues directrices soient constamment parallèles ; la barre de direction agit par l'intermédiaire d'engrenages, en attaquant le milieu de la barre d'accouplement (principe de l'essieu brisé) |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1830 |
|---|
William Mann, de Brixton, après trois années d'études, suggère, dans un opuscule, d'installer un réseau de stations de ravitaillement d'air comprimé espacées de 25 à 30 km le long des grandes routes. Il propose aussi la pose d'une conduite principale continue, en tube de fer comportant des points de livraison, dans les districts miniers. Mann prévoit que les véhicules fonctionnant selon son système devraient emporter une provision d'air comprimé dans des cylindres de 140 litres. Munis de 15 cylindres de cette capacité, remplis à la pression de 32 atmosphères, les chariots auraient, dit-il, une autonomie de 22 kilomètres ; à 64 atmosphères, l'autonomie serait de 55 kilomètres et la dépense moyenne ne devrait pas dépasser "un penny par mile." "Il conviendrait", écrit Mann, "d'employer les personnes détenues à Clerkenwell ou autres prisons, pour compresser l'air nécessaire à la propulsion des courriers de Sa Majesté à travers le royaume, elles paieraient ainsi leur nourriture." Cependant, ni Mann, ni son contemporain, Wright, qui fit breveter un véhicule propulsé par une machine combinée à vapeur et à air comprimé, ne semblent avoir réalisé concrètement l'objet de leurs recherches. |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1832 |
|---|
M. Selligues essaye de distiller les schistes d'Autun et donne naissance aux premières lampes à pétrole. |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1835 |
|---|
Service routier régulier automobile Paris-Versaille par remorqueur routier de Charles Dietz ; chariot à vapeur 10 tonnes, chaudière tubulaire, pouvant entraîner un véritable train routier ; premier à porter intérêt à l'élasticité des bandages, il interpose entre la jante de bois et le cercle d'acier une couche de feutre goudronné ou de liège |
Locomotive électrique de Thomas Davenport, à Troy, New York (4.10.1835) |
Véhicule modèle réduit du professeur Sibrandus Stratingh de Groningen, Hollande ; construit par son assistant, Christopher Becker |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1837 |
|---|
Inauguration de la ligne de chemin de fer de l'Ouest ; 26 minutes pour gagner Saint Germain, 35 km/h en pointe ; "à peine si l'on pouvait apercevoir les arbres au passage" |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1838 |
|---|
Robert Davidson (1804 - 1894) organise une exposition de machinerie électrique à Edimbourg, Ecosse : tours et presses d'imprimerie électriques ; l'exposition à lieu en 1840 dans la salle égyptienne de Piccadilly, à Londres ; Davidson construit, vers 1838, une locomotive électrique de 5 tonnes, alimentée par piles électriques ; elle parcourt plusieurs fois la ligne Edimbourg-Glascow à la vitesse de 6 km/h |
In 1838-9, an inventive Scotchman, named Robert Davidson, had built a lathe and a small locomotive for which electricity was the driving power. The motor for the locomotive consisted of two cylinders of wood fitted to the axles of four wheels, and furnished with four sets of iron armatures arranged to pass between the poles of eight electro-magnets. These were placed horizontally at the bottom of the car, two and two, by their opposite poles, in two opposite rows, so that each of the cylinders carried two sets of iron bars parallel to the axles. The bars presented themselves successively, as the cylinders rotated, to the poles of the corresponding opposite electro-magnets. When one of the bars on one side was opposite its magnet, one on the other side was just within range of the attraction of its electro-magnet. By this arrangement, it followed that the current was interrupted in the active electro-magnet and sent into the other, its vis-a-vis; and thus the axle was continuously turned. Acting together, the four sets of armatures and the two axles served to propel the car. Two sets of cells were employed, one for the electromagnets on the right and the other for those on the left. At each extreme end of the axles, inside the driving-wheels, were two small cylinders or commutators of ivory and metal upon which bore brushes leading the current from the batteries. Davidson's car was 16 feet long, six feet broad, and of five tons weight, including batteries. He drove it at a speed of four miles an hour with 40 cells composed of plates of iron and amalgamated zinc measuring 15 inches by 12. - T.C. Martin et J. Wetzler, The Electric Motor and its applications, 1891 |
Robert Davidson, of Aberdeen, was probably the first to make an electrically propelled carriage large enough to carry passengers. This he did in 1839. His carriage could carry two persons when traveling over a fairly rough road, and though the prospects were enticing enough to cause investment in the enterprise, Davidson's subsequent work was on rail vehicles. - Lyman Horace Weeks, Automobile Biographies, 1904 |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1840 |
|---|
Charles Goodyear (USA) invente la vulcanisation du caoutchouc |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1845 |
|---|
William Thomson (Ecosse) invente le pneu à chambre à air |
Machine à vapeur à piston rotatif d'Elijah Galloway ; brevet pour une machine à vapeur à piston rotatif ; épicycloïde intérieure et enveloppe extérieure (5 lobes) ; chaque lobe de l'enveloppe possède ses propres conduits d'admission et d'échappement |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1848 |
|---|
36.000 km de routes nationales et 43.000 de départementales en France |
Le 2 mars 1848, est votée la limitation du temps de travail à Paris à 10 h au lieu de 11 |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1849 |
|---|
Circulation automobile sur les voies publiques régie par les maires et préfets |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1851 |
|---|
Napoléon III instaure la conduite à droite le 30 mai 1851. On peut remarquer que le train, d'origine anglaise, roule à gauche, alors que le métro, d'origine française, roule à droite. |
Le Duc d'Aumont, célèbre par ses écuries (sous Louis-Philippe), imagine de faire traîner son landau par quatre chevaux attelés deux à deux, deux postillons, un sur le cheval de gauche du timon, l'autre sur celui de la volée, menant de son autre bras un autre cheval, dit "sous-verge" (bras droit fort pour tenir le cheval non monté). L'attelage dit à la d'Aumont est employé dans toutes les cours souveraines jusqu'à la domination de l'automobile. Pour pouvoir ramener l'attelage au milieu de la route bombée et pour ne pas être écrasé entre le bas côté et l'attelage en cas d'accident, il fallait rouler à droite. De plus, le cocher pouvait surveiller plus facilement le côté gauche lors des croisement. |
En Angleterre, les cochers conduisent en brides depuis le siège (attelage à l'anglaise). Le cocher était assis à droite pour ne pas gêner le passager avec son fouet. Pour éviter le fossé, en tirant sur son bras fort (le droit), il faisait obliquer l'attelage vers le côté droit. Lors des croisements, il lui était plus facile de surveiller le côté droit, plus exposé. Il était alors préférable de rouler à gauche. |
Le General Highways Act de 1773 recommande aux chevaux de circuler sur la gauche, disposition confirmée par le Highways Bill de 1835 |
Charles B. Page, de l'Office des Brevets des Etats-Unis, construit un petit véhicule qui fait le trajet de Washington à Bladensburg à la vitesse de 30 km/h |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1852 |
|---|
Véhicule électrique de ville à trois roues Autoette |
Studebaker (Etats-Unis) (1852-1966) |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1853 |
|---|
Création de la société Forest & Francis aux USA ; devient Swan Fich par la suite ; Motul figure parmi les marques distribuées ; importée en France en 1969 par la famille Zaugg (qui importe des huiles en Europe depuis 1932) et création de la société française Motul SA |
Projet de moteur subatmosphérique à naphte de pétrole de E. Bersanti et F. Matteucci (I) ; Ils déposent le brevet d'un moteur à gaz le 13 mai 1854 |
Les deux pistons, montés libres dans les cylindres, entraînent au moyen de tiges-crémaillères l'arbre d'un volant. Ignorant les tentatives précédentes faites en ce domaine, ils pensent qu'ils sont les inventeurs du moteur à gaz. L'idée revient à Eugenio Barsanti, ecclésiastique alors professeur dans une école de Florence, qui fut le théoricien, tandis que Felice Matteucci devait être le technicien capable de traduire les principes dans le métal. Barsanti conçoit un moteur à deux cylindres à pistons libres munis de tiges à crémaillères qui entraînent l'arbre solidaire d'un volant, au cours d'un cycle assez complexe à trois temps, car l'admission et l'explosion se produit pendant la même course du piston, contrairement à la disposition habituelle. La première démonstration publique de ce moteur a lieu en mai 1856 aux ateliers de la compagnie ferroviaire Maria-Antonia, à Florence, où il fait fonctionner une perceuse et une cisaille. Barsanti est comblé de joie de voir travailler son moteur : "Cette machine faisait déjà entrevoir qu'avant longtemps la puissance de la vapeur serait remplacée par une autre force moins coûteuse et aussi parfaite." Malheureusement, le prêtre inventeur est incapable de poursuivre dans la même voie jusqu'à l'obtention d'un résultat positif car, dès l'année suivante, il conçoit un nouveau moteur, doté de deux pistons en tandem par cylindre. Ce qui le conduit, en 1858, à un troisième schéma comportant cette fois deux pistons opposés, qui devait être installé dans un bateau, mais qui ne fonctionna pas. Le 10 octobre 1860, une société est constituée dans le but de construire des moteurs à gaz. Un nouveau type, encore plus complexe, de moteur à pistons opposés est construit pour le compte des associés par la société Escher & Wyss de Zurich. Une fois de plus il ne fonctionne pas comme on l'espérait. Les deux inventeurs se brouillent et Matteucci se retire " pour raisons de santé ", tandis que Barsanti revient à son moteur de 1857 à deux pistons en tandem. Bauer-Elvetica, entreprise napolitaine, en construit un exemplaire mais refuse de lancer une production en série. Cependant une entreprise beige de constructions mécaniques, John Cockerill, de Liège, s'intéresse à la construction du moteur à gaz de Barsanti. L'inventeur se rend en Belgique pour en faire la démonstration mais, atteint de typhoïde, il y meurt en arrivant. |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1854 |
|---|
Bordino |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1855 |
|---|
Travaux du baron Haussmann à Paris ; selon Boileau, au XVIIe siècle, dans "les embarras de Paris", "Des labyrinthes inextricables de ruelles étroites et encombrées d'échoppes, une circulation anarchique de carrosses et autres charrois, des foules de piétons indisciplinés se jetant sous les sabots des chevaux..." |
B. Silliman : découverte, par la distillation du pétrole, du goudron, des lubrifiants, du naphta, des solvants pour la peinture, de l'essence (Produit mineur utilisé comme détachant) |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1856 |
|---|
Moteur 2 temps à allumage par bec à gaz (transfert de flamme) de Hugon (F, 1856-1862) ; brevet du 11.9.1858, construction de moteurs fixes |
Foden Trucks (Grande-Bretagne - Sandbach, Cheshire) |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1857 |
|---|
Judkins, Merrimac, and Waterhouse Companies (Etats-Unis - West Amesbury, Massachusetts) |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1858 |
|---|
William Froude (GB, 1810-1879) créé un frein hydaulique pour la mesure des couples moteurs |
John Henry Knight réalise une machine à vapeur de bon rendement. Pionnier de l'automobilisme anglais né à Farnhan, dans le Surrey, en 1847, il s'est intéressé dès son jeune âge à des études et à des expériences sur la propulsion des véhicules. En 1870, il tente de construire un moteur â pétrole, mais il revient à la vapeur en réalisant le projet d'un propulseur de petite dimension qui n'a toutefois pas d'application pratique. Mécontent des résultats obtenus, il abandonne ses essais et ne recommence à s'occuper de véhicules qu'après 1890. |
Rickett (Grande-Bretagne) |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1862 |
|---|
Moteur 2 temps Dugald-Clerk avec précompression préalable |
Etienne Lenoir (France - Paris) (1882-1864) |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1863 |
|---|
Lenoir parcourt 9 km en 1 heure et demie ; Lenoir écrit : "Nous allâmes avec cette voiture de Paris à Joinville-le-Pont (à l'époque, village situé à 9 km de Paris). Le trajet dura une heure et demie et autant pour en revenir. La voiture était lourde; le moteur d'une puissance d'un cheval et demi avait un volant assez lourd et tourne à 100 tours par minute." ; le voyage fut ponctué de nombreuses pannes et ruptures, et la consommation de combustible et d'eau est jugée "considérable" ; Lenoir vend, en 1863, ses brevets à la Compagnie parisienne du gaz, mais il semble qu'il ait conservé sa voiture car il reçoit en 1864 la première commande d'une automobile à l'exportation, de la part du très francophile Tsar de toutes les Russies, Alexandre II ; la voiture est expédiée en Russie... et disparaît sans que l'on sache ce qu'elle devient ; les documents relatifs à cette cession seront exhumés à Paris en 1906, mais, malgré les recherches effectuées au palais impérial de Saint Petersbourg, on ne trouvera aucune trace de la Lenoir |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1864 |
|---|
Création de l'usine Gasmotorenfabrik à Deutz, par Otto et Langen ; moteurs industriels 2 temps 130 tr/mn (1872 : en 17 ans, 50.000 moteur) ; directeurs techniques Gottlieb Daimler (jusqu'en 1882) et Maybach |
Markus (Autriche) ; chariot tracté par une moteur à pétrole de Siegfried Markus en 1864 (1864-1877) |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1865 |
|---|
Utilisation d'un différentiel sur véhicule à vapeur Clayton and Shuttleworth |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1866 |
|---|
L'allemand Nikolaus August Otto brevette un moteur à gaz à piston libre  |
C'est le moteur à gaz de Lenoir qui inspire les recherches de l'allemand Nikolaus August Otto, qui tente de mettre au point un moteur à combustion interne utilisable dans tous les cas où la vapeur ne pouvait être employée. A la suite de nombreux essais, il fait la connaissance d'un riche ingénieur, Eugen Langen, avec qui il réussit à construire un moteur à piston libre, breveté en 1866 et construit commercialement en 1872. La société Otto et Langen est réorganisée sous l'appellation Gasmotoren-Fabrik Deutz, et un jeune ingénieur de trente-huit ans, nommé Gottlieb Daimler, est engagé comme directeur des usines en même temps que son assistant et protégé, Wilhelm Maybach, devient chef du bureau d'études et de dessin. Ils réorganisent l'usine en créant un système de production efficace en 1875, le chiffre des ventes annuelles atteint 634 moteurs pour une puissance totale de 735 ch. Le personnel comprend 230 personnes, et Maybach est gratifié d'une prime d'un thaler pour chaque moteur livré. Mais déjà le moteur à piston libre atteint les limites de son développement potentiel d'un fonctionnement sûr, selon les normes de l'époque, il est néanmoins bruyant et d'un rendement très médiocre. Sa puissance maximale ne peut guère dépasser 3 ch et, même dans ces conditions, ce moteur réclame un dégagement de 4 à 5 mètres pour le débattement de la tige du piston. Poussée par le succès initial de ses produits, la société Deutz se lance dans un ambitieux programme d'expansion mais, lorsque les ventes commencent à ralentir, la direction commande à Daimler de commencer les études d'un moteur "à pétrole". A la suite, Otto reprend ses recherches dans le domaine du moteur à quatre temps, système qu'il avait abandonné vers 1861-1862. En 1876, Otto essaye de monopoliser la production industrielle des moteurs à gaz en faisant breveter le cycle à quatre temps de manière à obliger les autres inventeurs à se cantonner au moteur à deux temps sous peine de procès. Or, en 1886, après deux années de procédure, le brevet Otto est annulé par un tribunal se fondant sur le fait qu'un "obscur ingénieur civil français", un nommé Alphonse Beau de Rochas, a, dès 1862, exposé dans un interminable et assez vague prospectus le principe du moteur à quatre temps qu'il voulait faire breveter. Par jugement du 30.1.1886, Otto doit verser 150.000 F Or à Delamare-Debouteville. |
Fondation de la Valvoline Oil Company (IG), pour la lubrification des soupapes de machines à vapeur ; Valvoline SARL, filiale de Fuchs (Allemagne) |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1867 |
|---|
Exposition Universelle : nombreuses voitures routières à vapeur exposées |
Jusqu'en 1867, pas de refroidissement sur les moteurs à vapeur et atmosphériques (faible vitesse linéaire du piston et puissance restreinte ne provoquant qu'un faible échauffement absorbé par la masse de fonte environnante) |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1869 |
|---|
Trajet Paris-Rouen-Paris par Michaux sur voiture à vapeur à 30 km/h de moyenne |
Ravel (France - Levallois-Perret) ; Joseph Ravel |
Motos Roper Steam Velocipede (Roxbury MA, USA) |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1870 |
|---|
Huile de Naphte (Distillation) pure ou mélangée à des graisses animales |
Refroidissement à eau thermo-siphon sur machine à vapeur Otto et Langen |
Refroidissement par air de De Bisschop sur machine à vapeur Otto et Lenoir ; cylindres allégés par ailettes longitudinales |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1871 |
|---|
Moteur 2 temps de Carl Benz (31.12.1871) |
Création de Continental (D, pneumatiques) ; fabrication de tuyaux et pièces en caoutchouc; pneumatiques en 1891 |
1er cycle motorisé, à vapeur, de Louis-Guillaume Perreaux |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1872 |
|---|
Amédée Bollée père (France - Le Mans) ; Amédée Bollée est le premier constructeur à construire des voitures de série (1872-1899) |
Char à vapeur L'Obéissante d'Amédée Bollée père ; fondeur de cloches au Mans, désireux d'avoir, pour son usage personnel, une voiture à vapeur de grande vitesse, s'attaque au problème de la direction ; invention de l'essieu directeur briséà deux pivots ; break à douze places, 4.8 tonnes, 40 km/h ; machine à vapeur 20 ch (360 litres d'eau pour une autonomie de 25 km) |
Le 9 octobre 1875, à l'aube, Bollée se met en route pour accomplir le trajet de 200 kilomètres qui doit le conduire jusqu'à Paris. A chaque changement de département, un inspecteur des Ponts et chaussées l'attend pour le soumettre à une longue liste de questions afin de juger si la voiture est ou non susceptible de dégrader les chaussées et s'il est opportun de la laisser poursuivre. La nuit est déjà tombée lorsque, dix-huit heures après avoir quitté sa remise, l'Obéissante franchit les fortifications à la lumière de son unique lanterne. Bollée avouera plus tard que ce voyage lui a valu 75 contraventions mais, après qu'il ait emmené à bord le préfet de police en personne, les procès-verbaux récoltés tout au long de la route n'ont eut aucune suite. L'Obéissante fait sensation dans les rues de Paris : partant de sa remise provisoire du quai de Jemmapes, elle circule dans le bois de Boulogne au milieu des plus brillants équipages et fait même l'ascension de la butte Montmartre. Mais, bien qu'il ait reçu de nombreuses demandes de la part d'acheteurs éventuels, intéressés par des répliques de l'Obéissante, aucun n'est passée à Amédée Bollée. Il construit ensuite un tramway à vapeur à quatre roues motrices, procède à d'intéressants essais mais rien n'en sort. |
Amélioration progressive des moteurs et adoption du cycle Beau de Rochas par Nikolaus Otto ; brevet alsacien du 6.6.1876, brevet allemand n° 532, 1.7.1877 ; moteur expérimental fixe le "bisaïeul" |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1874 |
|---|
Création de la SA Polaroil (lubrifiants) |
Jacquemin (France) ; véhicule à vapeur (1874-1878) |
Sir David Salomons (GB) développe une voiture avec un petit moteur électrique et une grand quantité de batteries ; la vitesse de croisière et l'autonomie sont très faibles |
Sir David Salomons, Bart., was born in England, in 1851. He was educated for a short period at University College, London, and afterwards at Caius College, Cambridge, where he was graduated with natural science honors. He is a member of the Institution of Electrical Engineers, where he took leading part for many years on the Council, and served in the positions of honorary treasurer and vice-president. He is a fellow of the Royal Astronomical So-ciety, of the Physical Society of London, and of the Royal Microscopical Society, and an associate of the Institution of Civil Engineers. Sir David was one of the first in England to adopt the electric light. This was about the year 1874, when he found it necessary to make the lamps, switches and other apparatus himself, as those were unobtainable at the time; much of the apparatus in general use to-day has been copied from his models. About 1874-5, he constructed a small electrical road carriage, which was in use a short time only, owing to the trouble of re-charging batteries, as no accumulators existed at that period. Devoting himself largely to scientific investigation he is the author of various works on scientific subjects, such as photographic optical formula^ photography and electrical subjects, his chief work being his three-volume Electric Light Installations, now entering its ninth edition. Of this work, the first volume on Accumulators was for a great many years the only practical work on the subject. He is also the author of many papers read before scientific societies, including the Royal Society and Royal Institution. He is an original member of the Automobile Club of France and of the Automobile Club of Great Britain, being a member of the committee of the former and member of committee and a vice-president of the latter, and is also an ordinary or honorary member of most of the Continental automobile clubs. He was Mayor of Tunbridge Wells, 1894-5, and High Sheriff of Kent in 1 88 1, and is a Magistrate for Kent, Sussex, Middlesex, Westminster and London. |
The connection of Sir David Salomons with the encouragement and development of self-propelled traffic in the United Kingdom, constitutes one of the most important chapters in the contemporaneous history of the automobile. His first step to secure a favorable public opinion for the legislative measures that he proposed was to have an exhibition of vehicles, which took place at Tunbridge Wells, in October, 1895. As a result of this exhibition and a voluminous correspondence thereafter, the newspapers of Great Britain and many of the members of the Houses of Lords and Commons were brought to see the justice of the measures asked for. Next, the Self-Propelled Traffic Association was organized. Sir David Salomons was elected president and the campaign for Parliamentary action was inaugurated and brilliantly and energetically prosecuted. When the bill came before the Commons and the Lords it was substantially supported, but its provisions received a great deal of discussion. Some amendments, particularly relating to the questions of smoke and petroleum use, were attached to it. In the end, however, the act that was passed was generally satisfactory to all interested in the promotion and protection of self-propelled traffic. It has been said that "there has hardly been an act passed containing more liberal clauses and with more unity of action." Its provisions allow of reasonable travel of all kinds of self-propelled vehicles throughout the Kingdom and the act as a whole is regarded as one of the most notable advances made in this matter during the present generation. - Lyman Horace Weeks, Automobile Biographies, 1904 |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1875 |
|---|
L'Obéissante, d'Amédée Bollée, reçoit 75 contraventions en ralliant le Mans à Paris à 13 km/h de moyenne |
Compléments des travaux de Sadi Carnot par Clausius |
Recherches autour du moteur verticale 2 temps atmosphérique de S Marcus (D et A, 1875-1883) ; nombreux brevets de détail ; moteurs fixes et un chariot expérimental (non considéré comme un véhicule automobile, commission Forestier, Dr M. Pfundner) |
1ère application industrielle du moteur à 4 temps par Otto, à l'Exposition Universelle de Paris, rendement 0.11 puis 0.20 |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1876 |
|---|
Otto Nikolaus Otto (1832-1891),ingénieur allemand né à Holzhausen, construit le premier moteur fiable à quatre temps (à gaz) le 9.5.1876 : régime de rotation 180 tr/mn, rendement 0.11 puis 0.20 (brevet DRP 532) . IL essaye de monopoliser la production industrielle des moteurs à gaz en faisant breveter le cycle à quatre temps de manière à obliger les autres inventeurs à se cantonner au moteur à deux temps sous peine de procès. Or, en 1886, après deux années de procédure, le brevet Otto est annulé par un tribunal se fondant sur le fait qu'un "obscur ingénieur civil français", un nommé Alphonse Beau de Rochas, a, dès 1862, exposé dans un interminable et assez vague prospectus le principe du moteur à quatre temps qu'il voulait faire breveter. Par jugement du 30.1.1886, Otto doit verser 150.000 F Or à Delamare-Debouteville. |
Franz Rings (Deutz), dessine pour la première fois un moteur à quatre temps, qui fonctionne dès l'automne |
Rings est le nouvel ingénieur en chef d'Otto (Gasmotoren-Fabrik Deutz). Otto essaye de monopoliser la production industrielle des moteurs à gaz en faisant breveter le cycle à quatre temps de manière à obliger les autres inventeurs à se cantonner au moteur à deux temps sous peine de procès. Or, en 1886, après deux années de procédure, le brevet Otto est annulé par un tribunal se fondant sur le fait qu'un "obscur ingénieur civil français", un nommé Alphonse Beau de Rochas, a, dès 1862, exposé dans un interminable et assez vague prospectus le principe du moteur à quatre temps qu'il voulait faire breveter. Otto est, bien entendu, très affecté par cette décision imprévisible mais qui constitue une étape fondamentale dans le développement de l'automobile. Désormais, les inventeurs qui s'étaient fourvoyés dans des recherches étrangères au brevet Otto peuvent se consacrer à des tâches relativement plus faciles qui consistent à améliorer le fonctionnement de ce moteur. |
Moteurs dits "série agricole" à 4 temps de Lenoir, Rouart et Mignon (1876-1881) ; grosse production de moteurs fixes ; 2 bateaux équipés (6 et 20 CV) |
Démarrage de la production de moteur à gaz dans l'usine Panhard d'Ivry; René Panhard (constructeur de machine à bois) ; terrains achetés en 1873, au 19 de l'avenue de la Porte d'Ivry à Paris |
Warp-8 (Owen Williams - Pays de Galle) |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1877 |
|---|
Le pétrole en 1877 |
En ce printemps 1877, la capitale mondiale du pétrole se nomme 0il City. Noblesse oblige, cette métropole de 9 000 habitants est située à 960 kilomètres à l'Est de New York, dans le nord-est de la Pennsylvanie. Là, l'artisanat est bien dépassé. L'époque est révolue où l'on creusait des excavations cubiques de trois mètres de côté, au fond desquelles on entassait des couvertures de laine que l'on tordait ensuite, pour en extraire le pétrole brut dont elles s'étaient imbibées. Dès 1859, on a su sonder à 200 mètres de profondeur et le pétrole a réellement jailli, se répandant dans les ravins en véritables rivières. Les prospecteurs ont appelé ces sources les "flowing'wells" et le flot des dollars a suivi celui du brut, donnant satisfaction à ceux qui avaient exigé quelques années plus tôt : "Oil, heIl or China !" à savoir du pétrole, l'enfer ou la fuite aux antipodes ! L'existence n'est pourtant pas toujours rose à Oil City. Les rues sont autant de ruisseaux de boue mêlée de brut et cette fange dégage de telles vapeurs qu'il a fallu purement et simplement interdire de fumer dans les limites de la ville. Quant aux habitants, ils ne se changent jamais : imbibés de pétrole, leurs vêtements ne peuvent être nettoyés et les ouvriers préfèrent les jeter... Il est vrai que les salaires sont dignes d'attention un charretier gagne 40 dollars par jour. Voici vingt ans, les U.S.A. exportaient du brut et les Français avaient installé des "distilleries" au Havre - déjà ! - à Rouen, Marseille et Paris. Mais, depuis 1870, l'Amérique préfère distiller elle-même. La plus grande distillerie est installée à Pisttburg ; équipée de dix "cornues", elle peut traiter simultanément 3 500 barils de brut ! Et ce pétrole, à quoi sert-il donc ? Dès 1832, Monsieur Selligues avait essayé de distiller les schistes d'Autun et les premières lampes à pétrole étaient nées. Aujourd'hui, l'éclairage au pétrole est entré dans les moeurs et les huiles et graisses de pétrole lubrifient toutes les machines. Une cohorte de chercheurs au premier rang desquels on distingue Monsieur Sainte-Claire Deville étudient également la possibilité d'utiliser l'huile lourde de pétrole comme combustible, pour actionner les chaudières des locomotives, voire pour alimenter des appareils de chauffage publics ou privés. Pour le moteur à explosion et les carburants Total, il faudra encore attendre un peu... |
Moteur 2 temps à compression extérieure de G. Brayton |
McCabe and Young Carriage Co (James H. McCabe, ex-Michael-Young Carriage Company - Etats-Unis - St. Louis, Missouri) |
Véhicule de G.B. Selden (USA) ; brevet demandé en 1877 obtenu le 5.11.1895 sous le numéro 549160 couvrant l'intégrité d'un véhicule et de son moteur ; utilisation du moteur G. Brayton de 1872 ; 2 répliques réalisées en 1906 ; débouté de toute prétention et antériorité après procès le 11.1.1911 |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1878 |
|---|
Amédée Bollée présente la Mancelle à l'Exposition universelle de Paris |
Si l'Obéissante a été un grand pas en avant, la Mancelle est un engin révolutionnaire qui préfigure, avec des années d'avance, l'architecture de l'automobile future. Son moteur à trois cylindres, placé à l'avant sous un capot, entraîne les roues arrière au moyen d'un arbre de transmission, de pignons coniques et de chaînes latérales. Il n'y manque que la boîte à vitesses, indispensable au moteur à pétrole, pour anticiper totalement le schéma général de l'automobile tel que Levassor le réinventera quinze années plus tard (mais Bollée réalise bientôt une Mancelle à deux vitesses). La suspension avant est aussi originale. Deux ressorts à lames transversaux permettent de doter chaque roue d'une suspension indépendante, tandis que la direction, comportant un pignon engrenant avec une crémaillère en arc de cercle et une biellette de chaque côté reliée au levier de direction, n'apparaîtrait pas démodée, dans son principe, sur une voiture moderne. La Mancelle, présentée à l'Exposition universelle de Paris de 1878, suscite un grand intérêt, au point que Bollée installe un atelier près de son usine et prend un concessionnaire général en la personne d'un nommé Lecordier, individu d'aspect lugubre, qui effectue un grand nombre de démonstrations le long des quais en proposant des répliques de cette voiture, carrossées soit en calèche, soit en chaise de poste au prix de 12 000 francs or. Ces essais ne furent pas exempts d'accidents. Un jour, Lecordier écrase un cheval et, une autre fois, engage une roue avant dans un rail de tramway, brisant net les ressorts avant. |
Jacquot (France) ; véhicule à vapeur |
Janin (France) |
Rouart Frères (France - Paris) (1878-1900) |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1880 |
|---|
Il existe en France 37 325 km de route nationales dont le crédit d'entretien s'élève à 30 millions de francs. |
Transmission par arbres à cardans transversaux d'Amédée Bollée |
1er moteur 2 temps à essence de Clark Dugald (ingénieur anglais) |
Moteur à cycle 2 temps de Clerk |
Conception et réalisation de moteurs monocylindre 4 temps alimentés au gaz puis à l'essence légère de pétrole par Edouard Delamare-Deboutteville (F, 1880-1884) ; reconnaissance des travaux de Beau de Rochas en 1883 lors d'un procès l'opposant à Otto (Jugement du 30.1.1886, 150.000 F Or à verser par Otto à Delamare-Debouteville) |
Voiture de Camille Faure et Jules Raffard (accumulateurs, 1880-1881) |
J.K. Starkley construit une petite voiture électrique (Angleterre) |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1881 |
|---|
Ernest Bollée présente la "Rapide", une six places "sportive", capable d'atteindre la vitesse de 60 km/h ; ses performances sont à l'origine de commandes supplémentaires de deux voitures à vapeur identiques ; comme la plupart des voitures construites par la famille Bollée, celle-ci fonctionnait correctement et longtemps ; vient ensuite un vaste mail-coach, destiné au marquis de Broc, qui semble avoir été l'oeuvre du fils aîné de Bollée, prénommé Amédée lui aussi ; d'une réalisation quelque peu bâclée, elle circulait encore, malgré son aspect rustique, vingt ans après |
Copeland (Lucius Copeland - Etats-Unis - Pheonix, Arizona) (1881-1891) |
De Dion-Bouton (France - Puteaux, Seine) ; Albert de Dion, Georges Bouton et Trépardoux (1881-1932) |
Tilbury à 2 places de Charles Jeantaud, installé aux Champs Elysées (ancienne maison Ehrler), constructeur parisien de voitures à chevaux ; motorisé par une machine de Gramme alimentée par une vingtaine d'éléments Fulmen ; il brûle à 100 mètres de l'atelier   |
Né à Limoges, d'un père carrossier, il fait son apprentissage à ses côtés.. A Paris, il travaillet chez Remery-Gauthier, puis chez Plillon (sur les Champs Elysées) et enfin, chez Moingeard, comme cadre supérieur. Il rachète Moingeard puis la maison Ehrler, carrossier de l'empereur, et s'installe sur les Champs Elysées. En 1878, il met au point "l'épure de Jeantaud" qui définit la géométrie des systèmes de direction. En 1881, il monte une vieille machine Gramme sur un tilbury à deux places, alimentée par une vingtaine d'éléments Fulmen. Tout est détruit par un incendie à 100 mètres de l'atelier. Début 1887, il installe un moteur lmmisch (anglais) et rejoint Courbevoie. Avec un moteur Thury (Genève) et avec 420 kg d'accumulateurs Fulmen, il parcourt 30 km à 20 km/h de moyenne. Il conçoit une nouvelle voiture, break 6 places à moteur Rechniewski 7 CV, pour la course Paris-Bordeaux de 1895 (deux fois 600 km). Avec une autonomie de 50 à 75 km à la moyenne de 24 à 30 km/h, il doit isntaller des postes d'échange des batteries tous les 40 km ('échange en moins de 10 minutes). Après un accident en se rendant au départ de la course, une fusée est faussée,n ce qui l'handicapera pour toute la course. Il arrive néanmoins à Bordeaux, à la moyenne générale de 16 km/h (7ème des temps réalisés). En 1896, il présente une voiture à traction avant et moteur transversal. Le 18 décembre 1898, le Comte Gaston de Chasseloup-Laubat établit le premier record de vitesse terrestre (course de vitesse pure lancée par le journal La France Automobile) avec 63,154 km/h, sur un Duc électrique Jeantaud, à Achères). Il atteint 70.585 km/h le 17 janvier 1899 puis 92.307 km/h le 4 mars (véhicule "gonflé" par Jeantaud à 40 ch). Camille Jenatzy et sa "Jamais Contente" auront le dernier mot le 29 avril avec 105.882 km/h. Jeantaud construit, au 51 rue de Ponthieu, à Paris, des coupés et des cabriolets, le conducteur restant en position haute, à l'arrière (1893-1906). Les roues arrière sont motrices, la transmission par chaîne, la direction généralement par volant et les roues pneumatiques. En 1903, les Jeantaud revendiquent 12.5 mph et une autonomie de 75 miles. De 1902 à 1904, il propose des véhicules à moteur ç essence assez semblables aux Panhard de 1898. |
Armand Peugeot (ingénieur à Leeds, GB) lance la fabrication de vélocipèdes Peugeot dans son usine de Beaulieu en 1881 ; une usine de fabrication et transformation de l'acier est fondée à Sous-Cratets (Doubs) en 1819 par Jean-Pierre et Jean-Frédéric Peugeot (Laminage à froid, ressorts, lames de scie) ; elle est baptisée "Peugeot Frères Aînés" en 1832 puis "Les Fils de Peugeot Frères" en 1876 ; des tricycles 2 places Peugeot sont exposés à l'Exposition Universelle de Paris 1889. |
Raffard (France) ; tricycle électrique (1881-1890) |
In 1881, Raffard, a French engineer, made a tricycle and a tram-car that is said to have been the first electric automobile which ran satisfactorily. - Lyman Horace Weeks, Automobile Biographies, 1904 |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1882 |
|---|
Locomotive Act en Angleterre (7.5.1882) : interdiction à une automobile de circuler sans être précédée d'un homme à pied agitant devant elle un drapeau; annulé en 1991 (longs efforts de sir David Salomon). |
Fabrique de moteur 2 temps à gaz de Carl Benz |
Moteur monocylindrique de Enrico Bernardi, baptisé, en l'honneur de sa fille, Motrice Pia ; ce groupe de 126 cm3 sert principalement à entraîner une machine à coudre. |
Embrayage à cône de friction de Gottlieb Daimler (23.9.1882) |
Le Marquis Alfred De Dion porte de l'intérêt à un petit moteur à vapeur extrêmement léger construit à Paris par Bouton, destiné à servir d'appareil de démonstration dans les laboratoires ; il songe à l'utiliser pour l'entraînement des véhicules ; tricycle phaéton et canot à vapeur De Dion et Bouton ; il participe à la course Paris-Bordeaux-Paris en 1895 puis au raid Pékin-Paris en 1907 |
Machine à vapeur de Parsons |
Adolf Spies démarre la fabrication de produits de peinture automobile en 1882 à Cologne ; Spies Hecker (Jaques Berger) rejoint le groupe chimique Hoechst en 1974 et s'implante à Limay (78) en 1985. |
Express Fahrradwerke Akt. Ges. (Allemagne - Neumark) (1882-1901) |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1883 |
|---|
Usine créée par Karl Benz à Mannheim |
Moteur à gaz vertical de Gottlieb Daimler (Brevets n° 28243 du 22.12.1883) ; coupleur pour transmission d'atelier (Brevets n° 26007 du 30.0.1883 et 28002 du 16.12.1883, moteurs fixes 4 temps à brûleurs) ; soupapes d'admission automatiques à ouverture par dépression et soupapes d'échappement commandées en ouverture: aubes sur le volant moteur (refroidissement moteur) |
Ayrton et Perry (Grande-Betagne - Londres) |
Premiére voitures légères à 3 et 4 roues à vapeur De Dion Bouton et Trépardoux ; marquis Albert De Dion et Georges Bouton, artisan, associés à Trépardoux ; un mécène, M. Chaumé de la Barre offre l'usine de Puteaux ; en 1894, le vicomte De Dion remporta l'épreuve Paris-Rouen sur un tracteur à vapeur construit par lui-même ; après divers insuccès dans les compétitions, il utilise le moteur à essence Daimler ; Trépardoux son partenaire, craignant la banqueroute, se retire |
Delamare-Deboutteville-Malandin (France - Rouen) (1883-1887) |
Tricycle Sociable d'Edouard Delamare-Deboutteville à monocylindre 4 temps, modifié au cours du printemps 1883 ; premier véhicule automobile mû par un moteur 4 temps à essence ; fonctionnement jugé satisfaisant |
Edison & Field (Etats-Unis - Chicago, Illinois) |
French Electrical Power Storage Co (Riffard - France) |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1885 |
|---|
Apparition de la bicyclette ; "... C'est vers 1885 qu'apparut la fameuse bicyclette à chaîne horizontale et à roues égales, instrument merveilleux de légèreté et d'élégance qui sillonne par milliers nos routes aujourd'hui. Le développement de la vélocipédie fut alors immense. On peut dire que l'invention de la bicyclette a complètement révolutionné le cyclisme en permettant aux personnes de tous les âges de pratiquer le sport sans les dangers du grand bi ni les fatigues de l'ancien tri. A vrai dire, ce grand succès a été aidé dans une certaine mesure par les perfectionnements considérables du tricycle devenu aujourd'hui beaucoup plus léger et gracieux. (Paul Verlin, l'Illustration, 30.5.1891) |
Moteur fixe 4 temps de Gottlieb Daimler pour utilisation en atelier (Brevet n° 34926 du 3.4.1885) |
Voiture à deux places d'Amédée Bollée fils (Le Mans, Sarthe) ; Après avoir englouti une belle fortune dans la construction des voitures à vapeur, Amédée Bollée père décide que le moment est venu d'arrêter cette activité et refuse toute nouvelle commande. Toutefois, il ne peut empêcher son fils Amédée de construire lui-même, en 1885, une petite voiture à deux places. En réalité, le marché n'est pas mûr pour le véhicule automobile. Seuls, les initiés les plus enthousiastes, comme Gustave Koechlin qui achète une Mancelle en 1878, avant de devenir plus tard un des hommes clefs dans la conversion de Peugeot à la construction automobile, étaient prêts à s'accommoder de ses nombreux défauts. |
Belgica - Société ancienne des Cycles et Automobiles Belgica (Belgique - Bruxelles) ; fabricant de cycles à Bruxelles depuis 1885 ; produit des voitures de 1902 à 1909 ; les dernières Belgica sont commercialisées sous le nom Saventhem-Belgicas ; la firme est rachetée par Excelsior en 1909 |
Benz & Co.- Rheinische Gasmotorenfabrik (Allemagne - Mannheim) ; Karl Friedrich Benz, Karslruhe, tricycle 1886 ; première Benz vendue à Paris, à la même époque en 1887 (1885-1926) |
Daimler (Gottlieb Daimler - Allemagne - Cannstatt) |
Victoria à pétrole Daimler ; moteur de 0,5 ch dans le cadre d'un bicycle dépourvu de suspension |
"Daimler, qui a quitté Otto en 1881, travaille alors avec Wilhelm Maybach, dans un atelier de sa maison de Cannstatt, à la mise au point d'un moteur à régime rapide, adaptable à un véhicule et utilisant un système d'allumage par tube incandescent breveté par Maybach, plus grossier mais plus sûr que les systèmes électriques de l'époque. Benz avait conçu son moteur comme une partie intégrante de la voiture qu'il se proposait de fabriquer. Daimler, de son côté, considère son groupe comme un moteur universel susceptible de faire fonctionner des machines industrielles comme des véhicules, et effectue ses premiers essais au mois de novembre 1885, en installant un moteur de 0,5 ch dans le cadre d'un bicycle dépourvu de suspension. Il attend que ce moteur ait donné la preuve de son fonctionnement avant de le monter dans une voiture qui est, cette fois encore, un phaéton à quatre places construit par une entreprise de carrosserie qui ignore jusqu'à la fin que la voiture n'est pas destinée à être attelée. En fait, Daimler n'émet aucune condition particulière en passant sa commande, sauf que la voiture doit être ""élégante et très solidement construite"" car il entend l'offrir à son épouse pour son anniversaire. Il semble bien qu'il ait voulu préserver le secret jusqu'au bout. La voiture est livrée, et le moteur et la transmission sont installés par les ateliers Esslingen. Le haut du moteur dépasse le plancher devant la banquette arrière et la transmission finale est simplement constituée par une courroie à deux rapports, entraînant un arbre de renvoi porteur d'un pignon à chaque extrémité, engrené sur une couronne dentée solidaire de chaque roue arrière. Malgré la rusticité de sa conception, la voiture Daimler fonctionne bien, mais elle ne constitue qu'un épisode au milieu de la production de moteurs destinés à toutes sortes d'usages, pompes à incendie, bancs de scies ou ballons dirigeables. La demande devient si importante que Daimler et Maybach doivent s'établir dans une usine plus vaste et ils rachètent les ateliers d'une ancienne entreprise de nickelage. C'est là que les deux associés mettent au point l'un des principaux moteurs de cette période de tâtonnements, un bicylindre en V de 565 cm3. Avec ses deux cylindres à 20 degrés, il possède un excellent rapport poids-puissance et tourne au régime de 630 tr/mn, bien plus vite que ses concurrents. Il constituera pendant bien des années le plus moderne des groupes moteurs alors disponibles pour les constructeurs d'automobiles. Wilhelm Maybach dessine une voiture autour de ce bicylindre en V en 1889." |
Motos Copeland Steam (Phoenix AZ, USA) |
Daimler Einspur ; bicycle en bois, dépourvu de suspension, à moteur monocylindre 4 temps à essence à refroidissement par air avec turbine et carburateur de Gottlieb Daimler ; brevets n° D-36423 du 29.08.1885 et F-171261 du 21.12.1885 ; parcourt 10 km |
Daimler Victoria à pétrole ; Le moteur monté sur le bicycle Einspur ayant donné la preuve de son fonctionnement, Daimler décide de le monter dans un phaéton à quatre places construit par une entreprise de carrosserie qui ignore jusqu'à la fin que la voiture n'est pas destinée à être attelée. Daimler demande seulement que la voiture soit "élégante et très solidement construite" car il entend l'offrir à son épouse pour son anniversaire. La voiture est livrée, et le moteur et la transmission sont installés par les ateliers Esslingen. Le haut du moteur dépasse le plancher devant la banquette arrière et la transmission finale est simplement constituée par une courroie à deux rapports, entraînant un arbre de renvoi porteur d'un pignon à chaque extrémité, engrené sur une couronne dentée solidaire de chaque roue arrière. Malgré la rusticité de sa conception, la voiture Daimler fonctionne bien, mais elle ne constitue qu'un épisode au milieu de la production de moteurs destinés à toutes sortes d'usages, pompes à incendie, bancs de scies ou ballons dirigeables. La demande devient si importante que Daimler et Maybach doivent s'établir dans une usine plus vaste et ils rachètent les ateliers d'une ancienne entreprise de nickelage. |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1886 |
|---|
Après deux années de procédure, le brevet Otto (moteur à quatre temps) est annulé. Le tribunal se fonde sur le fait qu'un "obscur ingénieur civil français", un nommé Alphonse Beau de Rochas, a, dès 1862, exposé dans un interminable et assez vague prospectus le principe du moteur à quatre temps qu'il voulait faire breveter. Otto est, bien entendu, très affecté par cette décision imprévisible mais qui constitue une étape fondamentale dans le développement de l'automobile. Désormais, les inventeurs qui s'étaient fourvoyés dans des recherches étrangères au brevet Otto peuvent se consacrer à des tâches relativement plus faciles qui consistent à améliorer le fonctionnement de ce moteur. |
Benz : coupleur industriel Benz (brevet n° 42819 du 1.9.1886) et régulateur pour groupe électrogène (brevet n° 43638 du 8.4.1887) |
Moteur horizontal Benz (300 tr/mn) porté à 500 tr/mn de 1892 à 1900, serpentin pour le refroidissement |
Karl Benz : Renvoi d'angle dans le rapport 1/1 |
Daimler : appareil doseur de mélange (Brevet n° 36811 du 25.03.1886) ; motopropulseur pour bateau (Brevet n° 39361 du 09.10.1886) ; pas de brevet déposé pour la 1ère voiture Daimler à 4 roues |
1er moteur 2 temps "moderne" de Ravel (transferts et déflecteur) |
Benz Motorwagen Tricycle DDM 37/435 (Karl Friedrich Benz, Karslruhe) ; brevets n° D-37435 du 29.1.1886 et F-175027 du 21.7.1886 ; première sortie le 3 juillet 1887 ; monocylindre 4 temps (Benzol) 1050 cm3 (91.4x160), 0.86 ch à 200 tr/mn, transmission par chaîne, 250 kg, 13 à 16 km/h ; fonctionnement jugé précaire et pas sûr par Karl Benz ; un lourd volant moteur est monté horizontalement sous le châssis, Benz pensant que l'effet gyroscopique d'un volant vertical peut influencer la direction dans les virages.  |
Brush Electric Co (General Manager N. S. Possons - Etats-Unis - Cleveland, Ohio) ; Broc 1909-1910, Broc Carriage & Wagon Co Cleveland OH, 1910-1914, Broc Electric Vehicle Co, Cleveland, 1914-1916, American Broc, Saginaw MI with Argo & Borland-Grannis |
Daimler, charette à quatre roues à moteur à pétrole (carrosse à l'origine) ; première sortie le 4 mars, 17.5 km/h le 9.5.1986 ; pas de brevet déposé) |
Durant-Dort (Etats-Unis) (1886-1914) |
The Electric Construction Company Ltd (Thomas H. Parker et P. Bedford Elwell - Grande-Bretagne) (1886-1896) |
Hammel (Danemark) |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1887 |
|---|
1ère course automobile organisée par Possier, rédacteur du magazine "Le Vélocipède", avec un seul participant, Georges Bouton, sur quadricycle 4 places à vapeur |
Daimler : échappements pour moteurs fixes (brevet n° 44526 et 44554 du 15.11.1887) |
Benz, première voiture réellement utilisable (voyage de B. Benz en août 1888) ; perfectionnements de la première voiture ; brevets n° 43742 du 08.04, 43826 du 08.04.1887, 175027 du 29.09.1887 ; lancement commercial annulé faute de clients ; première Benz vendue à Paris, à la même époque |
De Dion Bouton Type I, tricycle à vapeur à 2 cylindres horizontaux, 4 à 5 ch, roue arrière motrice entraînée par bielle, frein à ruban sur la roue arrière, 325 kg, 20 km/h |
De Dion Bouton Type II fin 1887, à direction améliorée, puis type III jusqu'en 1893 |
Jeantaud à moteur Immisch ; arrive à Courbevoie (accus vidés). |
Millet, bicyclette à moteur rotatif |
Morrison Electric (William Morrison - Etats-Unis - Des Moines, Iowa) (1887-1896) |
Serpollet (France - Paris-Montmartre) ; Léon Serpollet (1887-1898) |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1888 |
|---|
Première autorisation officielle de procéder à des essais au volant de véhicule automobile décerné à Carl Benz le 1.8.1888 (premier permis de conduire) |
Thermo-siphon Benz et Daimler, réservoir en U (1888-1897) |
Benz : coupleur inverseur pour bateau (brevet n° 46612 du 9.8.1888) |
Moteur 2 temps Ravel : déflecteur vertical sur la tête de piston, transferts opposés diamétralement |
Benz, tricycle à l'Exposition technique de Munich |
Benz se propose de débuter une fabrication de véhicules destinés à une utilisation pratique. "Le véhicule à moteur n'a pas le même usage ni les mêmes caractéristiques que le vélocipède, que chacun peut utiliser pour d'agréables randonnées sur des routes de campagne plates et bien entretenues. Il est plutôt conçu comme un chariot ou une charrette de paysan et convient non seulement pour voyager sur les routes faciles, mais aussi pour transporter de lourdes charges sur des itinéraires montagneux. Il permettra, par exemple, au voyageur de commerce de transporter ses échantillons d'un point à un autre en toute facilité... Nous sommes certains que ce véhicule est promis à un bel avenir car outre sa facilité de conduite, il deviendra, dès que sa vitesse sera suffisamment améliorée, un des moyens de transport les plus économiques et les plus rentables..." Malgré toutes ces bénédictions, la voiture est encore loin de pouvoir être offerte à la vente mais, vers 1888, Benz estime que le moment était venu d'exposer au public la nouvelle version, plus robuste, de son tricycle. Au mois de septembre, il l'envoie à l'Exposition technique de Munich et se livre publiquement à un certain nombre de démonstrations. "Rarement, sinon jamais jusqu'à présent", écrit un chroniqueur, les passants des rues de notre ville ont eu l'occasion d'assister à un aussi étrange spectacle que celui qui leur fut offert, samedi après-midi, lorsqu'une voiture légère déboucha sur la Sendlingertorplatz par la Sendlingerstrasse et fila à bonne vitesse vers la Herzog Wilhelmstrasse sans le secours d'un quelconque cheval ou d'un moyen apparent de traction, conduite par un homme assis sous un dais, qui se dirigea vers le centre de la ville, propulsé sur trois roues, l'une à l'avant et les deux autres à l'arrière. L'étonnement de ceux qui le virent dans la rue les mit dans l'incapacité de comprendre de quoi il s'agissait." En regard de ces considérations trop enthousiastes, l'Annuaire des sciences naturelles d'Allemagne se contente d'imprimer "Benz construisit aussi une voiture à pétrole qui fit quelque bruit à l'Exposition de Munich. Cette utilisation du moteur à pétrole sera probablement dans le futur aussi peu intéressante que celle de la vapeur en ce qui concerne la locomotion sur route." Bien entendu, aucun acheteur ne se manifeste. Benz présente sa voiture au public comme "un agréable véhicule susceptible de gravir les montagnes", mais il apparaît plutôt, lorsque sa famille "emprunte" l'une des premières voitures pour effectuer un voyage improvisé, que la transmission à un seul rapport est mal adaptée au franchissement des côtes. Il y eut sans doute deux voitures Benz vendues à des particuliers l'une à l'agent parisien des moteurs à gaz Benz, Emile Roger, l'autre, conservée de nos jours au Science Museum de Londres, est très certainement la première automobile importée en Grande-Bretagne. |
Bersey (Walter C. Bersey - Grande-Bretagne - Londres) ; omnibus à traction électrique de Walter C. Bersey ; avec Desmond Fitzgerald, il doit inventer une pile sèche afin de propulser son engin en vue de sa commercialisation ; un fourgon de livraison parcourt 1600 km en 1894 (1888-1899) |
Coventry Machinist Company (ex-Coventry Sewing Machine Company, J.K Starley - Grande-Bretagne - Coventry) |
De Dion Bouton type III ; 2 cylindres 4 ch, 187x125 cm, 325 kg, 20 km/h |
Exide (The Electric Storage Battery Co. - Etats-Unis - Philadelphie) (1888-1913) |
Henriod (Fritz Henriod - Suisse - Bienne) |
Fred M. Kimball (Etats-Unis - Boston, Massachussets) |
Langenthal (Suisse - Langenthal) |
Magnus Volk (Grande-Bretagne - Brighton) |
Moritz Immisch et Magnus Volk (Grande-Bretagne - Brighton, Londres) |
A.L. Riker Electric Motor Co - Riker Eklectric Vehicle Co (Etats-Unis - Brooklin, New York) ; Andrew Lawrence Riker (1888-1901) |
Roger - Roger-Benz (France - Paris) ; Emile Roger, Ets Roger-Benz (1888-1896) |
Tricycle à vapeur de Serpollet ; Les autorités militaires françaises sont intéressées par cette invention et demandent un essai. Tout va pour le mieux jusqu'à ce qu'un officier demande à Serpollet d'essayer les freins ; il tire le levier alors que la vitesse est d'environ 25 km/h la voiture stoppe mais pas l'officier, qui culbute par-dessus le tablier. |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1889 |
|---|
Gottlieb Daimler engage une de ses voitures dans une course à Nice ; son coéquipier et ami Emil Jellinek s'inscrit sous le pseudonyme Mercedes (prénom de sa fille) ; Daimler gagne et décide de donner à ses voitures le prénom porte-bonheur |
Boites de vitesses à poulies plates (1889-1902) |
Refroidissement par tubes à ailettes Grouvelle ; radiateur en tubes aluminium et ailettes acier (rapport de dilatation), application à l'automobile 02.1898 |
Daimler : divers groupements de cylindres pour moteurs et pompes ; brevet n° 50839 du 9.6.1889, base des travaux de Panhard et Levassor ; bicylindre en V 4 temps (900 tr/mn) à culasse seule refroidie par eau monté sur Panhard de 1891 à 1892 et Peugeot de 1891 à janvier 1897 |
De Dion Bouton : embrayage à segments garnis de fibres dans l'huile (Mâchoires dans tambours) ; abandonné en 1907 (ne convient que pour de faibles puissance) |
Pneu à chambre à air de John Boyd Dunlop (Ecosse) : "... Enfin, dernière transformation, toute récente celle-là, qui provoque presque une crise dans la fabrication des cycles, les caoutchoucs ont été complètement modifiés depuis le commencement de l'an dernier. Au lieu des minces bandes de gutta couvrant à peine des jantes très étroites, on voit surgir depuis quelques mois des vélos à caoutchoucs énormes qui ressemblent parfois à des bouées de sauvetage ! Caoutchoucs pneumatiques et caoutchoucs creux ou coussins (en anglais cushion tyres), tels sont les noms des nouveaux systèmes, tous les deux d'invention anglaise.   |
Le caoutchouc pneumatique Dunlop (du nom de l'inventeur, M. Dunlop de Belfast) est le premier et le plus connu. C'est un tube flexible de caoutchouc pur (D) épais de Z millimètres, d'environ 37 millimètres de diamètre et coupé d'une longueur égale à la circonférence de la roue à laquelle il doit être appliqué. Ce tube est fixé dans un second tube de toile (C) pourvu d'ailes (C') qui permettent de le fixer à la jante (G). Une soupape à air (E) ayant été adapté et les extrémités du tube ayant été réunies, une enveloppe extérieure de caoutchouc (A) de 10 millimètres d'épaisseur vers son milieu et de 2 millimètres sur les côtés est cimentée avec la toile qui enferme le tube et s'étend sur ses bords. Enfin, une autre couche de toile est collée à la jante pour assurer le tout et lui donner un aspect convenable. Le cycliste gonfle le caoutchouc pneumatique au moyen d'une petite pompe à air ad hoc qu'il porte avec lui et qui s'adapte à la soupape. Le caoutchouc creux dans sa forme primitive la plus simple se compose d'un tube de caoutchouc traversé dans toute sa longueur par un canal plus ou moins circulaire. Ce vide intérieur permet au caoutchouc de se déplacer rapidement sous une charge, particulièrement lorsqu'il passe sur les inégalités de la surface d'une route ; il le rend plus élastique que le caoutchouc plein. Le caoutchouc creux est moins gros et, partant, moins disgracieux que le pneumatique. Sa moyenne est de 25 à 40 millimètres. Les opinions des cyclistes sont fort partagées sur les avantages et les inconvénients des deux systèmes, et il est bien évident qu'on en est encore à la période des tâtonnements. Au pneumatique paraît appartenir l'avenir, mais lorsqu'il aura subi certains perfectionnements qui l'empêcheront de crever - inconvénient qui a déjà disparu dans une notable mesure, surtout pour les pneumatiques de route, plus solides que ceux de course. Actuellement, le pneumatique est le meilleur caoutchouc pour la course, et le creux pour la route, tout bien considéré. Le poids de la machine se trouve forcément augmenté par l'adaptation de ces nouveaux caoutchoucs ; mais on peut presque entièrement regagner la différence en construisant la partie métallique avec plus de légèreté et, somme toute, l'ensemble du véloce est beaucoup plus protégé contre les trépidations - cause principale d'usure - que dans les anciennes machines. Les résultats obtenus avec les caoutchoucs creux ou pneumatiques sont d'ailleurs magnifiques. Sur de bons terrains, ils donnent, à effort égal, une augmentation de vitesse sensible, mais où leurs avantages sont inappréciables, c'est sur les routes mal pavées où le vélocipédiste était le plus souvent obligé de mettre pied à terre et où il peut aujourd'hui rouler confortablement.. Paul Verlin, l'Illustration, 30.5.1891 |
Fondation de la firme Michelin à Clermont-Ferrand ; fondation d'une usine de machines agricoles en 1831 par Aristide Barbier et Edouard Barbier; époux d'une nièce du chimiste écossais MacIntosh ; Daubrée se lance dans la production de caoutchouc manufacturé, avant de céder l'entreprise au gendre de Barbier ; Jules Michelin, père d'Edouard Michelin, est le véritable fondateur de la marque |
Daimler bicylindre à l'Exposition de Paris |
Daimler et Maybach mettent au point l'un des principaux moteurs de cette période de tâtonnements, un bicylindre en V de 565 cm3. Avec ses deux cylindres à 20 degrés, il possède un excellent rapport poids-puissance et tourne au régime de 630 tr/mn, bien plus vite que ses concurrents. Il constituera pendant bien des années le plus moderne des groupes moteurs alors disponibles pour les constructeurs d'automobiles. Wilhelm Maybach dessine une voiture autour de ce bicylindre en V. Cette réalisation à roues en fil d'acier est inspirée, comme la Benz née quatre ans plus tôt, par la technique bicycliste contemporaine, tout en étant d'une bien meilleure architecture que la première Daimler. Elle figure à l'Exposition de Paris de 1889, où elle attire énormément l'attention. L'un de ses passagers les plus intéressés n'est autre que René Panhard qui, conjointement avec son associé, Emile Levassor, et l'amie de celui-ci, Louise Sarazin, veuve du représentant en France des moteurs Deutz depuis 1874 (qui avait conseillé à sa femme, sur son lit de mort, de poursuivre son association avec Daimler), projette de construire des moteurs Daimler à usage industriel. A la suite de cette Exposition, Mme Sarazin signe un contrat qui lui assure les droits de production, en France et en Belgique, des moteurs à essence Daimler. En 1890, Levassor épouse Louise Sarazin et Panhard et Levassor commencent la production des moteurs Daimler. Inconscients des possibilités futures de la voiture sans chevaux, ils rétrocèdent à Peugeot le droit d'employer ces moteurs dans des véhicules, car cette dernière firme, intéressée par la construction d'un véhicule automobile, vient de renoncer à la fabrication en série de la voiture de Serpollet.. |
Daimler Sthlradwagen : boîte à 4 vitesses par engrenages droits |
Thomas Edison (Etats-Unis) ; véhicule expérimental servant de test pour ses batterie nickel/fer ; les batteries nickel/fer Edison seront utilisées par Bailey Electrics, entre autres ; Edison achètera une Studebaker Electric |
McCabe-Young and Company (John J. Rich - Etats-Unis - St. Louis, Missouri) |
Panhard et Levassor - Panhard (France - Ivry / Paris) ; René Panhard, Emile Levassor ; Périn fonde une petite entreprise de construction de machines pour le travail du bois en 1845, à à Paris ; le jeune ingénieur René Panhard le rejoint en 1867 et l'entreprise est transférée quelques années plus tard avenue d'Ivry ; en 1872, Emile Levassor. ancien camarade d'études de Panhard, entre dans la société, et, en 1886. à la mort de Périn, la raison sociale devient Panhard et Levassor ; les deux associés sont amis d'Edouard Sarazin qui, conjointement avec Gottlieb Daimler. détient l'exclusivité pour la France de ses brevets pour un moteur à combustion interne d'encombrement réduit ; l''usine Panhard et Levassor est ainsi chargée de construire quelques exemplaires du moteur ; Sarazin meurt en 1887 et sa veuve, à qui Daimler a assuré la continuité de l'exploitation de ses brevets, épouse peu après Emile Levassor ; en 1889, après avoir convaincu Armand Peugeot, autre illustre pionnier de l'automobile, de construire un quadricycle équipé du moteur Daimler produit en France, Panhard et Levassor décident d'entreprendre eux mêmes la réalisation d'un véhicule automobile, fondant ainsi celle qui est considérée comme la plus ancienne marque française d'automobile (1889-1967) |
Panhard et Peugeot furent les plus anciennes fabriques françaises de véhicules automobiles dotés de moteur à combustion interne. La longue histoire de Panhard s'est terminée en 1965 lors de la fusion avec Citroën, bien que la production de ses modèles ait été prolongée deux ans. Il n'est pas étonnant que ce soit précisément en France que automobile ait trouvé sa destination. c'est-à-dire un véhicule de grande diffusion qui allait influencer son époque. Déjà, à la fin du siècle dernier, la France possédait une industrie bien outillée, une main d'oeuvre spécialisée et elle était riche de matières premières. Ce pays portait donc en soi les conditions essentielles pour le développement du nouveau moyen de locomotion et il ne tarda pas à en faire une réalité. L'origine de La maison Panhard remonte au milieu du siècle précédent (1845) lorsqu'un certain Périn fonda à Paris une petite entreprise de construction de machines pour le travail du bois. En 1867. le jeune ingénieur René Panhard se joignit à l'entreprise qui, quelques années plus tard, fut transférée avenue d'Ivry, adresse qui allait ensuite devenir célèbre et immuable. En 1872, Emile Levassor. ancien camarade d'études de Panhard, entra dans la société, et, en 1886. à la mort de Périn, la raison sociale devint Panhard et Levassor. C'est à ce moment que se produisit un curieux hasard qui allait orienter la maison vers l'automobile. Les deux associés étaient amis d'Edouard Sarazin qui, conjointement avec Gottlieb Daimler. détenait l'exclusivité pour la France des brevets d'un moteur à combustion interne d'encombrement réduit, fruit des études de ce dernier. L'usine Panhard et Levassor fut ainsi chargée de construire quelques exemplaires du moteur. Sarazin mourut en 1887 et sa veuve, à qui Daimler avait assuré la continuité de l'exploitation de ses brevets, épousa peu après Emile Levassor, qui se trouva donc en mesure de disposer personnellement du capital de sa femme. En 1889, après avoir convaincu Armand Peugeot, autre illustre pionnier de l'automobile, de construire un quadricycle équipé du moteur Daimler produit en France, Panhard et Levassor décidèrent d'entreprendre eux mêmes la réalisation d'un véhicule automobile, fondant ainsi celle qui est considérée comme la plus ancienne marque française d'automobile. Ainsi naissait la première Panhard, qui était en réalité un chariot avec moteur central, assemblé par Levassor avec la collaboration de son contremaître Mayade, en qui il avait toute confiance. Après de nombreuses tentatives, la voiture réussit, en janvier 1891, à parcourir sans arrêt les vingt kilomètres du parcours Ivry - Point du Jour. A la suite de ce succès, les premières commandes arrivèrent et six voitures sortirent de l'usine, dont quatre avec le moteur à l'avant. Il s'agissait du 2 cylindres en V de 75 x 120 mm conçu par Daimler. La puissance était de quelques chevaux et la vitesse maximale ne dépassait pas 30 km/h. Les Panhard représentèrent, jusqu'à l'apparition de la Mercedes, construite d'après le projet de Maybach au début du XXe siècle, la voiture la plus élaborée du point de vue technique. |
Sa conception, dite "système Panhard", influença la fabrication des véhicules de nombreuses autres marques. Ce système consistait essentiellement en la boîte de vitesses à engrenages coulissants, le type d'embrayage et la transmission à chaînes latérales. en outre, la disposition classique des différents organes mécaniques était déjà définies, à savoir le moteur à l'avant, puis la boite de vitesses et enfin la transmission. En 1895, le 2 cylindres en V fut remplacé par le Phénix à deux cylindres en ligne, innovation due à Levassor, avec un nouveau type de carburateur. Deux version étaient initialement proposées : un 3 HP de 75 c 140 mm et un 4 HP de 80 x 120 mm. A ceux-ci venaient s'ajouter, en 1896, le premier 4 cylindres construit spécialement pour les voitures participant à la course Paris-Marseille-Paris. Malheureusement, pendant cette course, Emile Levassor fut victime d'un grave accident et mourut des suites de ses blessures. Son poste à la direction technique de l'entreprise fut alors repris par Arthur Krebs, ancien officier et ingénieur militaire, qui perfectionna encore la voiture Phénix, dont la version finale, à moteur quatre cylindres, atteignit presque 7 litres de cylindrée (130 x 140 mm). La maison, qui avait changé en 1897 sa raison sociale en Société Anonyme des Anciens Etablissements Panhard et Levassor, pratiqua jusqu'aux premières années du siècle une politique publicitaire fondée sur une participation intense aux événements mondains et sportifs. Dès juillet 1894. elle fut présente au Concours pour voitures sains chevaux organisé sur le parcours Paris-Rouen par Pierre Giffard, concours qui fut la première manifestation de sport automobile en sens propre. Sur les 21 voitures au départ, quatre étaient des Panhard et, à l'arrivée, le jury attribua à la maison d'Ivry, de même qu'à Peugeot, le premier prix de 5 000 francs-or pour ses réalisations qui avaient fourni les performances correspondant à l'esprit de la manifestation. En 1896, Panhard gagna la course Paris-Marseille-Paris, avec Mayade, puis en 1898, la course Paris-Amsterdam, avec Charron, et, en 1899, le Tour de France, avec De Knyff. Ces grandes courses de vile à ville furent suspendues après la course Paris-Madrid de 1903, interrompue à Bordeaux à cause des tragiques accidents survenus au cours de son déroulement. Les compétitions furent reprises ensuite suivant des critères différents et disputées sur des circuits fermés susceptibles d'offrir davantage de sécurité. Un des premiers fut le Circuit des Ardennes, où, précisément, Panhard s'affirmait en 1902, 1903, 1904. Parallèlement, il y avait eu l'époque de la coupe Cordon Bennett, disputée de 1900 à 1905, dont Panhard gagna les deux premières éditions. A partir de 1906, Panhard opta pour une politique commerciale qui visait à la valorisation de l'automobile comme véhicule de tourisme, et non plus comme engin sportif. |
C'est dans ce contexte que s'inséra la publicité du premier 6 cylindres, dont le projet fut établi en 1905, avec une cylindrée de plus de 11 litres et destiné à une série de voitures imposantes. En 1905, le radiateur à serpentin fut abandonné définitivement pour le radiateur en nid d'abeilles, tandis qu'en 1907 l'embrayage à cône de cuir fut remplacé par des disques multiples. Les innovations techniques étaient introduites avec beaucoup de prudence, d'autant qu'à cette époque la maison conservait une attitude essentiellement conservatrice. Cependant, les voitures jouissaient d'une renommée établie et elles étaient très appréciées de la clientèle. Adolphe Clément était entré dans l'entreprise en qualité de directeur commercial à la suite de la disparition de Levassor. C'est de cette époque que datent les Panhard-Clément, voiturettes équipées d'un moteur monocylindre conçu par Krebs et vendues directement par la maison Clément & Cie du Pré-Saint-Gervais. Ce fut le seul cas ou le nom de Panhard se trouva associé à celui d'une autre entreprise de construction d'automobiles, d'ailleurs pour des raisons contingentes plutôt qu'en vertu de sa propre initiative. Après le départ d'Adolphe Clément et la mort de René Panhard, en 1908, la responsabilité de l'entreprise fut assurée par Hippolyte Panhard, jusqu'en 1915, puis par Paul Panhard jusqu'à la fusion avec Citroën. La maison Panhard et Levassor fut une des premières en Europe à s'intéresser au marché des Etats-Unis. Après un début malheureux (la première voiture exportée fut mise sous séquestre par La douane américaine) la maison réussit à s'implanter rapidement et sa réputation fut renforcée par le succès obtenu dans la première édition de la coupe Vanderbilt, disputée en 1904. En cette occasion, Heath, sur la version 90 HP de 15 litres, se plaça devant A, Clément, sur Clément-Bayard, et Lyttle, sur Pope Toledo. Ce fut le dernier succès prestigieux de la marque française qui allait abandonner définitivement l'activité sportive, exception faite des tentatives de record. Dans la première décennie du siècle, la maison d'Ivry, tout en devant faire face à une concurrence acharnée, conserva toujours une position solide sur le marché, ce qui lui permit de destiner une partie de ses ressources à la construction de moteurs pour dirigeables et avions. C'est à 1910 que remontent l'utilisation châssis en tôle emboutie et l'abandon de la transmission à chaîne, remplacée sur tous les modèles par la transmission à cardan, qui fut bientôt universellement employée. A côté de ces nouveautés techniques, une innovation allait caractériser la production Panhard : il s'agissait de l'adoption du moteur à fourreau imaginé par Charles Knight, qui avait déjà trouvé des partisans convaincus, comme Daimler en Angleterre et Minerva en Belgique. |
"le technicien Krebs on avait étudié le fonctionnement et, à partir de 1908, débutèrent les premiers essais. L'introduction du moteur ""sans soupapes"" permit en outre de couper définitivement tout rapport avec Daimler Motoren Gesellschaft. à laquelle revenait (en vertu de l'accord conclu en 1886 entre Daimler et Sarazin et repris par la suite par la maison Panhard et Levassor) 10 % sur la valeur de chaque moteur produit. La production des derniers moteurs traditionnels cessait en 1913, tandis que la première génération des moteurs sans soupapes Panhard et Levassor réalisés en différentes versions à quatre et six cylindres, influença d'autres constructeurs français comme Voisin et Peugeot. Pendant la guerre. la maison Panhard et Levassor se consacra à La fabrication d'armes, de munitions et de véhicules militaires. A la fin du conflit, la nécessité de reconvertir la production incomba à l'ingénieur Pestourie, qui avait succédé à Krebs en 1916. Les premiers modèles d'après-guerre apparurent en mars 1919 et furent dénommés 10 HP ut 16 HP. La 10 HP, avec moteur sans soupapes à quatre cylindres (60 x 105 mm) fut équipée de freins sur les quatre roues. En 1922, le premier 8 cylindres de 6 355 cm3 (88 x 140 mm) fut présenté. En 1924. la société parisienne reprit les Ateliers de carrosseries d'Orléans et fut ainsi en mesure de fabriquer entièrement ses voitures. Dans cette même période, la maison Panhard et Levassor décida de profiter des installations de Montlhéry pour procéder à des tentatives de records de vitesse. La première voiture préparée à cette fin, et dénommée ""Lame de Rasoir"" avait été conçue par un jeune ingénieur du bureau d'études, nommé Breton qui fut victime d'un accident mortel lors d'un essai. Le moteur était initialement de 1 500 cm3, mais il fut ensuite remplacé par un autre beaucoup plus puissant, de presque 5 litres. En 1926. cette voiture améliora le record de l'heure en le portant 93,600 km/h. Huit ans plus tard, un autre prototype, d'une puissance de 300 ch, piloté par Eyston, atteignit les 210.300 km/h. La machine avait été dessinée par Louis Bomier qui, conjointement avec l'ingénieur Pasquelin, assumait la direction technique de l'entreprise depuis 1930. C'est à Ces deux techniciens que revient le mérite de la réalisation de la Dynamic, qui était une voiture de conception d'avant-garde : châssis à poutre centrale, suspensions à barres de torsion, freins hydrauliques. Les phares étaient encastrés dans les ailes, les quatre roues carénées et le volant en position centrale, déplacé par la suite sur la gauche. Malheureusement, la guerre alors imminente en limita la production qui prévoyait la possibilité d'installer trois moteurs 6 cylindres, toujours à fourreau, respectivement de 2 500, 2 700 et 3 800 cm3 de cylindrée." |
L'entreprise se ressentait encore en 1938 des effets de la crise économique qui s'était produite au début des années trente et elle travaillait très au-dessous de sa capacité de production. Antérieurement à la Dynamic avait eu lieu le développement des séries CS, avec moteur à six cylindres, et DS, avec moteur à huit cylindres, boite à quatre vitesses et châssis surbaissé. Les carrosseries. fournies par l'établissement d'Orléans, se distinguaient par leurs formes particulières et leurs ailes de grand volume. Pendant la guerre et sous l'occupation allemande, la production fut interrompue, mais la direction mûrit de nouveaux projets qui allaient se concrétiser dès la fin des hostilités. La conception de la grande voiture de luxe était écartée au profit d'un véhicule de dimensions réduites avec un faible coût d'entretien et un prix modique apte à favoriser la reprise de l'industrie. L'ingénieur Jean Albert Grégoire avait fait le projet d'une petite voiture à traction avant avec moteur refroidi par air, dont le prototype fut réalisé on 1947 par la Société de l'Aluminium Français. la maison Panhard et Levassor en acquit le droit de reproduction et la direction technique de la société s'appliqua à parfaire le projet qui, une fois les travaux termines, restait conforme aux conceptions de base de Grégoire. Ainsi naissait la Dyna, à carrosserie en aluminium, avec moteur à deux cylindres de 610 cm3 (72 x 75 mm), qui devait ensuite être également construite en Allemagne sous le nom de "Dyna-Veritas". Elle avait un moteur à arbre à cames central et soupapes en tête, rappelées par des ressorts à barres de torsion, une puissance de 30 ch. En 1949, la cylindrée fut portée à 745 cm3 (79,5 x 75 mm) et la puissance passa à 35 ch. En 1950, la production annuelle de la Dyna dépassa les 10 000 unités et, vu le succès obtenu par la version normale, on songea à réaliser également une version sportive. Ainsi sortirent la DB-Panhard et la Monopole-Panhard, voitures équipées de la mécanique de la Dyna et qui se distinguèrent aux vingt-quatre heures du Mans dans le classement à l'indice de performance et au Rallye de Monte-Carlo. Parallèlement à la Dyna, on avait étudié le projet de la Dynavia, qui en reprenait les mêmes conceptions et qui influença grandement la production de série des années cinquante. Ces modèles, dénommés Dyna 54, furent équipés d'une carrosserie extrêmement légère on alliage d'aluminium, spécialement étudiée par l'institut aérotechnique de Saint-Cyr, en collaboration avec les Laboratoires Eiffel. Le moteur, d'une cylindrée de 850 cm3 (85 x 75 mm), développait 52 ch à 5000 tr/mn. |
"En 1955, prés de 20 000 Dyna 54 sortirent des usines d'lvry. Cependant, au cours de cette période, la maison Panhard commença à sentir l'influence de la maison Citroën, avec laquelle elle avait déjà conclu un accord, de sorte qu'une partie de ses établissements était destinée au montage de la version commerciale de la 2 CV Citroën. Pour des raisons d'ordre économique les carrosseries en alliage léger furent remplacées par celles en tôle emboutie. En 1959, la Dyna fut rénovée et prit le nom de PL 17. La collaboration devenue plus étroite et les deux dernières versions, sorties au début des années soixante et dénommées 24 CT et 24 BT, disposaient de 50 et 60 ch. Elles étaient la synthèse des efforts conjugués des bureaux techniques des deux maisons. Ces modèles ne donnèrent toutefois pas les résultats commerciaux espérés et, à la suite d'une baisse constante des ventes, la société Citroën décida, en 1965, d'absorber la société Panhard avec Levassor, qui perdait ainsi son autonomie après soixante-quinze ans d'activité dans l'automobile. " |
Premier moteur à quatre temps sur une voiture à quatre places par Panhard ; chariot à moteur central assemblé par Levassor avec la collaboration de son contremaître Mayade, en qui il a toute confiance ; 2 cylindres en V Daimler 1060 cm3, puissance de quelques chevaux, vitesse maximale 30 km/h ; conception dite "système Panhard" : moteur à l'avant, puis boite de vitesses et enfin transmission, avec boîte de vitesses à engrenages coulissants, embrayage et transmission à chaînes latérales ; après de nombreuses tentatives, la voiture réussit, en janvier 1891, à parcourir sans arrêt les vingt kilomètres du parcours Ivry - Point du Jour ; à la suite de ce succès, les premières commandes arrivèrent et six voitures sortirent de l'usine, dont quatre avec le moteur à l'avant |
Automobiles Peugeot (France - Beaulieu / Audincourt / Sochaux) ; une usine de fabrication et transformation de l'acier est fondée à Sous-Cratets (Doubs) en 1819 par Jean-Pierre et Jean-Frédéric Peugeot (Laminage à froid, ressorts, lames de scie) ; elle est baptisée "Peugeot Frères Aînés" en 1832 puis "Les Fils de Peugeot Frères" en 1876 ; le sigle est "la marque que la maison Peugeot frères entend apposer sur ses scies, articles laminés, de taillanderie et autres" déposée le 20 novembre 1858 par Emile Peugeot, manufacturier à Valentigney ; le lion symbolisait les trois qualités des lames de scie Peugeot : La résistance des dents, la souplesse et la rapidité de coupe ; le lion des armes de Franche-Comté apparaît sur les Peugeot 203 en 1948  |
tricycles 2 places Peugeot à l'Exposition Universelle de Paris ; moteur à vapeur à générateur Serpollet |
2 prototypes de quadricycles biplace Peugeot à moteur Daimler 565 cm3 placé à l'avant ; Armand Peugeot réalise le premier quadricycle à gazoline, la Type 2. ; moteur Daimler produit en France par Panhard et Levassor |
Slattery - Fort Wayne Jenny Electric Light Co (Etats-Unis - ...) |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1890 |
|---|
Première course automobile américaine à Springfield; vainqueur A.L. Ricker sur véhicule électrique |
La fin des années 1880 connut les expérimentations prometteuses des de Dion, Bouton et Trépardoux, et celles de Léon Serpollet, mais leur temps est encore à venir. Quant à la vapeur, elle ne devait jamais apporter l'automobile aux masses. |
Vers 1890, culasses à circulation d'eau fabriquée pour les voiturettes à moteur arrière (Clément-Panhard, Mors, Decauville, Clément, Vivinus, etc.) |
Refroidissement à eau par thermo-siphon jusqu'en 1890 (emploi occasionnel de petites pompes à piston mûes par le moteur pour faciliter le thermo-siphon) ; pompes centrifuge entraînée "en bout" |
Sur les Benz : eau portée à ébullition circulant dans un condensateur qui condense la vapeur d'eau après passage dans une chemise ; abandonné en 1898 (problèmes d'étanchéïté) |
Différentiel "plat" (1890-1930) |
Les pneumatiques Continental s'implante en France, à Paris |
Panhard et Levassor commencent la production des moteurs Daimler. En 1890, Levassor épouse Louise Sarazin, détentrice des droits de production, en France et en Belgique, des moteurs à essence Daimler. Première série de voitures destinées à être vendues à la clientèle (Evolution du brevet Daimler 50839 de 1889) |
Butler Petrol Cycle (Edward Butler - Grande-Bretagne - Londres) |
Copeland (Etats-Unis) ; l'américain Lucius Copeland se lance dans l'industrie automobile ; promoteur d'un vaste projet qui devait déboucher sur la fabrication, vers 1890, de "phaéton-Moto-Cycles" en série, il n'en vend aucun et se retire ainsi d'une industrie encore en gestation, convaincu que personne ne serait jamais disposé à se séparer de quelques dizaines de dollars en échange d'un véhicule automobile |
Daimler Motoren Gesellschaft (Gottlieb Daimler - Allemagne - Cannstatt) (1890-1902) |
Le premier cabriolet mû par un moteur à explosion fonctionnant au pétrole circule dans la cour de l'usine Panhard et Levassor ; dos-à dos (deux sièges opposés), bicylindres en V, 25 km/h ; en 1891, Levassor put conduire sa voiture sa voiture sur une distance de huit kilomètres jusqu'au Point du Jour et la ramener avenue d'Ivry sans qu'elle eût éprouvé la moindre défaillance ; ; inconscient des possibilités futures de la voiture sans chevaux, il rétrocède à Peugeot le droit d'employer ces moteurs dans des véhicules, car cette dernière firme, intéressée par la construction d'un véhicule automobile, vient de renoncer à la fabrication en série de la voiture de Serpollet. |
3 prototypes Peugeot à moteur à essence Daimler (venant de chez Panhard-Levassor) placé à l'arrière |
Scania - Vagnfabriks-Aktiebolaget i Södertelge (Suède) ; première voiture à moteur à combustion interne suédoise en 1898 ; fusion avec Vabis en mars 1911 (AB Scania- Vabis) |
Secrétant (France) (1890-1892) |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1891 |
|---|
Parution du "Vélo" |
Pierre Giffard est pionnier du journalisme de son époque, grand reporter-bourlingueur du Figaro. Appelé par Hippolyte Marinoni à rénover et à diriger le service des informations du Petit Journal (tirage 1 500 000 exemplaires), il en devient éditorialiste et, du haut de sa tribune, exprime avec chaleur son coup de coeur pour le vélocipède qu'il présente au public comme un "bienfait social". Conquis par le sport, il lui consacre son temps, ses idées, il est ainsi l'organisateur de ce monument du cyclisme le Paris-Brest-Paris de 1891 (1 200 kilomètres sans arrêt). Le succès populaire de l'épreuve l'incite à prendre son indépendance vis-à-vis du Petit JournaL Il s'évade et s'échappe du conventionnel et de la routine du quotidien d'actualité en enfourchant un "vélo", raccourci de vélocipède dont il fait un mot à la mode et le titre du journal qui aura une prise immédiate sur le sport français, activant sa popularité, donc sa pratique et son développement économique. Pierre Giffard peut compter en toute logique sur le soutien publicitaire des constructeurs du cycle et de l'automobile. Chacun y retrouve son compte : l'éditeur, le sport, l'industrie. Pourtant, cette entente basée sur une convergence d'intérêts, qui fonctionne avec efficacité les premières années, s'altère avec le temps et ne résiste pas aux courants d'opinion qui s'affrontent à propos de l'affaire Dreyfus. Pierre Giffard prend position publiquement ; fasciné par le " J'accuse " de Zola, il ne se place pas dans le même camp que ses principaux commanditaires et se brouille avec le plus influent d'entre eux, le comte de Dion, puissant patron de la marque des premières voitures compétitives, en s'associant à Georges Bouton, un modeste mécanicien de la rue de Charonne. De cette brouille naîtra "l'Auto", en 1901, ancêtre de "L'Equipe" |
Bi-cylindre en V, culasse refroidie par eau uniquement |
Continental fabrique des pneumatiques pour vélos, automobiles et avions |
Fernand Forest (ingénieur français) met au point définitivement le moteur à explosion quatre temps alimenté par l'essence de pétrole ; 1er moteur 4 cylindres verticaux équilibrés (300 tr/mn) |
André et Edouard Michelin propose le brevet du pneu démontable |
Holtzer-Cabot Co (Etats-Unis - Brookline MA) (1891-1893) |
Première vente de Panhard-Levassor à moteur bicylindre Daimler (30.10.1891) ; série de 30 voitures à pétrole, 28 km/h, 3500 F; Catalogue tarifs en 1892 (1891-1900) |
Quadricycle 2 places Peugeot Type 2 ; 4 exemplaires vendus |
Peugeot Type 3 ; quadricycle 4 places en vis à vis, moteur V2 Panhard-Levassor sous licence Daimler ; 2.5 CV, 565 cm3, 2 ch à 1000 tr/mn, 500 kg, 20 km/h ; 64 exemplaires fabriqués à Valentigney de 1891 à 1897 ; sur une type 3, trajet des usines Peugeot de Valentigney (Doubs) à Paris, puis course cycliste Paris-Brest-Paris (première longue distance parcourue par une automobile) et livraison au client à Mulhouse ; 2000 km parcouru dont 1200 de la course à 14.7 km/h de moyenne (le vainqueur cycliste Terront gagnant à 16.9 km/h) ; Koechlin premier de la course automobile Paris-Bordeaux-Paris en 1895 ; 64 exemplaires de laType 3 fabriqués à Valentigney de 1891 à 1897 (1891-1897) |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1892 |
|---|
Moteur horizontal Benz de 1886 (300 tr/mn) porté à 500 tr/mn de 1892 à 1900 ; serpentin pour le refroidissement |
Moteur horizontal Daimler Phoenix de Maybach ; culasse et cylindre refroidis par eau (cylindre monobloc) ; monté sur Panhard de 1892 à 1899 |
De Bourmont (France) (1892-1895) |
Desnoyers (France) (1892-1968) |
Le Blant (France) (1892-1896) |
The London Electrical Cab Company (Grande-Bretagne - Londres) (1892-1905) |
Peugeot Type 4 ; quadricycle 4 places en vis à vis construit pour les déplacements en France du Bay de Tunis (un seul exemplaire, voiture dite "Marguerite") ; moteur V2 Panhard-Daimler 3.5 CV, 1018 cm3 4 ch, 520 kg, 25 km/h |
Quadricycles Peugeot électriques |
Achille Philion (Etats-Unis - Akron, Ch) |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1894 |
|---|
Concours de dessin pour de nouvelles carrosseries lancé par Le Figaro |
Concours pour voitures sans chevaux organisé en juillet 1894 sur le parcours Paris-Rouen par Pierre Giffard (première manifestation de sport automobile en sens propre) ; 102 concurrents dont 30 moteurs à pétrole, 7 à gazoline, 1 à essence minérale, 1 à pétroles combinés, 28 moteurs à vapeur, 1 à vapeur combiné ; 4 moteurs électriques ; 3 moteurs hydrauliques, 1 à eau comprimée, 1 à liquides combinés, 4 à air comprimé, 1 à gaz comprimé, 1 électro- pneumatique, 1 à gaz et pesanteur ; 13 moteurs à levier, 2 à balanciers, 1 à système de leviers multiples, 1 à pédales, 5 moteurs "automatiques", 1 mécanique ; droit d'entrée non remboursable de 10 F, 69 véhicules restant : 37 à pétrole, 28 à vapeur et les 4 électriques ; éliminatoire de 50 km (En moins de 3 heures), seuls restant en lice 25 concurrents : 14 à pétrole, 7 à vapeur et les 4 divers (Non électriques) ; 1er, véhicule à vapeur 4 places de Dion et Bouton, à 20 km/h de moyenne ; sur les 21 voitures au départ, quatre étaient des Panhard et, à l'arrivée, le jury attribua à la maison d'Ivry, de même qu'à Peugeot, le premier prix de 5 000 francs-or pour ses réalisations qui avaient fourni "les performances correspondant à l'esprit de la manifestation". |
Organisée par Pierre Giffard du Petit Journal cette épreuve vit l'inscription de 102 concurrents... alors qu'à cette date on dénombrait officiellement, à peine une centaine d'automobiles en France... C'est dire assez que les chercheurs potassaient sérieusement la question ! Certes à côté d'industriels et de gens sérieux comme MM De Dion-Bouton, Panhard-Levassor, ou Peugeot il y avait de petits artisans sans grands moyens mais avec des idées (déjà), et aussi des rêveurs, voire des illuminés que par discrétion pour leur éventuelle descendance nous nous abstiendrons de citer. En tous cas, la liste des engagés témoigne assez de l'état d'esprit régnant alors, et de l'engouement très vif pour cette naissante "voiture sans chevaux". Parmi les 102 engagés on trouvait donc comme mode de propulsion : moteurs à pétrole : 30, moteurs à vapeur : 28, moteurs à gazoline : 7, moteurs automatiques (?) 5, moteurs électriques : 4, moteurs à air comprimé : 4, moteurs à leviers : 13, moteurs hydrauliques : 3, moteurs à balanciers : 2,... et à un représentant unique : moteurs à eau comprimée, à gaz comprimé, à essence minérale, à pétroles combinés, à systèmes de leviers multiples, mécaniques (?), à liquides combinés, à vapeur combinée, électro-pneumatiques, à gaz et pesanteur, à... pédales (drôle de moteur quand même !). Rassurons tout de suite nos lecteurs. Prudent, Giffard, avait d'abord réclamé un droit d'entrée non remboursable (Té, pardine !) de 10 F, puis organisé une éliminatoire de 50 km. Ce fut la douche froide et seuls restèrent en lice 69 véhicules, soit 37 à pétrole, 28 à vapeur et les 4 électriques. Nouvelle hécatombe à l'issue de l'éliminatoire dont il ne sortit plus que 25 concurrents, à savoir 14 à pétrole, 7 à vapeur et 4 divers... qui n'avaient rien d'électrique. Ces derniers étaient-ils dans les choux ?... Non ils furent simplement "absents". Deux d'entre eux resteront à jamais anonymes, l'histoire n'ayant même pas retenu le nom de leur auteur. Quant aux deux autres, l'un était anglais et son constructeur l'avait modestement (sic) baptisé "la voiture de l'avenir"... Est-ce la raison pour laquelle le propriétaire de l'unique exemplaire refusa obstinément de le prêter ? En tous cas, il ne passa pas le Channel. L'autre voiture électrique était celle du Comte Carli... qui fut sauvé du ridicule par notre ineffable Administration. En effet, pour motif de paperasseries diverses à établir, les Douanes bloquèrent l'engin... jusqu'au lendemain de l'éliminatoire. Ouf pour elle et surtout son conducteur !... Ainsi, la voiture électrique ne put prendre part à la première course automobile du monde. Mais elle allait peu après, brillamment se rattraper en pulvérisant les premiers records mondiaux de vitesse. Gilbert Lecat, le Distributeur Automobile, 1988 |
Moteur De Dion Bouton à soupapes d'admission automatiques à ouverture par dépression et soupapes d'échappement commandées en ouverture |
1er moteur 4 cylindres de Forest (300 tr/mn) |
Audibert, Lavirotte et Cie (France - Lyon), petite entreprise française d'automobiles fondée vers 1894 ; ateliers de Montplaisir-les-Lyon et de St-Chamond ; voiture en 1895 ; le 25 mars 1901, les associés Audibert et Lavirotte prennent le volant de deux voitures de leur marque dans la course Nice-Salon-Nice mais aucun des deux ne parvient au terme de l'épreuve et, depuis cette date, la marque ne fait plus jamais parler d'elle ; la production totale ne dépassa pas 50 exemplaires (1905-1903) |
Baker & Elberg (Etats-Unis - Kansas City MO) (1894-1895) |
Balzer (Steven Balzer - Etats-Unis - New York) (1894-1901) |
Benz monocylindre 1050 cm3, 1.5 ch à 450 tr/mn, boîte 2 vitesses, 225x125 cm, 280 kg, 20 km/h  |
Bremer (Grande-Bretagne) |
Joseph Carli (Italie - Castelnuovo) |
Dasse (Belgique - Verviers) (1894-1924) |
Le vicomte De Dion remporta l'épreuve Paris-Rouen sur un tracteur à vapeur 4 places construit par lui-même, à 20 km/h de moyenne ; après divers insuccès dans les compétitions, il utilise le moteur à essence Daimler ; Trépardoux son partenaire, craignant la banqueroute, se retire  |
Delahaye (France - Tours / Paris) ; Emile Delahaye (1894-1954) |
Electric Carriage & Wagon Co (Etats-Unis - Philadelphie) ; Henry G. Morris & Pedro G. Salom (1894-1901) |
Electrobat - Morris & Salom (Etats-Unis - Philadelphie) ; Electrobat utilisées comme taxis à Philadelphie et à New York ; l'une d'elles prit part à la course du Times Herald de Chicago, mais abandonna avant d'atteindre le but ; les roues avant (plus grandes que les roues arrière sur les premiers exemplaires) étaient entraînées par deux moteurs électriques (1894-1897) |
Garrard & Blumfield (Grande-Bretagne - Coventry) ; voiture électrique (1894-1896) |
Gautier-Wehrlé - Société Continentale d'Automobiles (France) ; ancienne fabrique française de voitures à cheval qui se consacre à la construction d'automobiles vapeur, à essence et électriques de 1894 à 1900 ; pendant une certaine période égaiement, les deux ingénieurs Gautier et Werhlé fabriquent des châssis et des carrosseries destinés aux voitures à vapeur Serpollet ; les premières Gautier-Wehrlé, équipées de moteurs à vapeur, réussissent à se classer honorablement dans plusieurs courses d'endurance organisées en France au début du siècle ; le modèle le plus connu, baptisé Cigale, reçoit une chaudière Serpollet ; en 1897, l'entreprise devient la Société continentale d'automobiles et construit les premières voitures à moteur à explosion (1894-1897) |
Haynes-Apperson Company (Elwood Haynes, Elmer and Edgar Apperson - Etats-Unis - Kokomo, Indiana) (1894-1904) |
Voiture Jeantaud à moteur Thury (de Genève) ; 420 kg d'accus Fulmen, 30 km à 20 km/h de moyenne ; performances insuffisantes pour l'éliminatoire de Paris-Rouen (50 km en moins de 3 heures requis) |
Né à Limoges en 1840, d'un père carrossier, Charles Jeantaud fera très tôt son apprentissage à son côté. Tout jeune, il "monte" à Paris, où il travaillera successivement chez Remery-Gauthier, puis chez Plillon (aux Champs Elysées) et enfin, chez Moingeard, que, cadre supérieur, il finira par racheter. Son affaire prospère, et Jeantaud sur sa lancée, rachètera également la maison Ehrler, carrossier de l'empereur... aux Champs Elysées, (son rêve !).. Mais, voilà, comme un virus, Jeantaud a contracté une passion : l'automobile électrique ! Oh ! il a de bonnes raisons pour cela. N'est-ce pas chez lui que Philippart avait amené la Mancelle-Bollée à vapeur pour être transformée en "électrique" par le génial Raffart. Le carrossier, de seize ans plus jeune, voue une admiration sans réserve pour l'ingénieur et rêve de suivre sa voie. Il a déjà bricolé un tilbury à deux places sur lequel a été greffée une vieille machine Gramme alimentée par une vingtaine d'éléments Fulmen, et le tout grillera allègrement à quelques centaines de mètres de ses ateliers. Qu'importe ! Début 1887, il installe sur l'engin un moteur lmmisch, fabriqué en Grande-Bretagne, et cette fois, il arrivera à Courbevoie : accus vidés ! Le moteur sera remplacé par un Thury de Genève et avec 420 kg d'accus Fulmen, parcourra 30 km à 20 km/h de moyenne. Insuffisant toutefois pour l'éliminatoire du Paris-Rouen (50 km en moins de 3 h) et le carrossier-constructeur piétinera jusqu'à la fin de l'année 1894 où, l'annonce du "Paris-Bordeaux-Paris" fixé pour la mi-juin 1895, viendra le galvaniser. |
Klaus (France) (1894-1899) |
Fiacre automobile Krieger avec batterie Fulmen  |
Record de distance par Louis Krieger  |
M.L.B. - Landry & Beyroux (France - Paris) (1894-1902) |
Moritz Immisch (France) (1894-1897) |
Panhard et Levassor dans la course Paris-Rouen ; sur les 21 voitures au départ, quatre étaient des Panhard et, à l'arrivée, le jury attribueà la maison d'Ivry (et à Peugeot), le premier prix de 5 000 francs-or pour ses réalisations, elles qui "ont fourni les performances correspondant à l'esprit de la manifestation" |
Pennington (Edward Joel Pennington, Kane & Company - Etats-Unis - Chicago) |
40 Peugeot produites |
Pilain (France - Lyon) ; François Pilain (1894-1898) |
Quentin Frères (France - Valenciennes) ; Phaéton à 2 cylindres horizontaux (1894) |
Rochet-Schneider (France - Lyon) (1894-1932) |
Scotte (France - Lyon) (1894-1900) |
Vacheron (France - Montherme) (1894-1896) |
Vallée (France - Le Mans) ; F. Vallée (1894-1901) |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1895 |
|---|
Création de l'Automobile Club de France par le Comte De Dion, la baron de Zuylen de Nyevelt de Haar et le journaliste Paul Meyan ; assemblée constitutive le 12.11, désignant comme présidents d'honneur MM Marcel Deprez et Georges Berger, président M de Zuylen, vice-présidents MM Ménier et De Dion ; secrétaire général M Meyant, secrétaire technique comte H. de la Valette, trésorier André Lehideux |
Course de côte organisée à Chanteloup |
Une nouvelle formule de course automobile était née, qui connaissait déjà un vif succès (lequel se poursuivra jusqu'à la seconde guerre mondiale) : la course de cote. La plus célèbre était alors celle de Chanteloup, près du passage à niveau d'Argenteuil. De 2 % au départ, la cote atteignait 10 % vers l'arrivée 1 800 mètres plus loin. Les essais confirmèrent Chasseloup-Laubat. Sa voiture grimpait plus vite que les plus rapides à pétrole (celles à vapeur trop lourdes étant déjà hors course). Pourtant le jour de la course, il remarque l'arrivée parmi les concurrents d'une lourde "wagonnette" ne payant guère de mine, celle d'un jeune belge fabricant de fiacres électriques assez lents : Camille Jenatzy. Une pluie torrentielle s'abat sur la course et Chasseloup-Laubat ne pourra même pas prendre le départ, ses chaînes sautant à chaque démarrage. C'est Jenatzy qui enlèvera l'épreuve, et ce sera le début d'un duel épique entre ces deux adeptes de l'automobile électrique, qui tour à tour seront "l'homme le plus rapide du monde", et pour Jenatzy du moins, le premier à avoir franchi le "mur" des 100 km/h, une vitesse qui semblait inaccessible encore en cette dernière année du dix neuvième siècle ! En tous cas, pendant un temps, tous deux "survoleront" nettement les voitures à pétrole et à vapeur (encore que pour ces dernières Serpollet créera "la surprise" en étant le premier à Nice, à dépasser les 120 km/h). Mais pendant que les deux hommes se volent mutuellement la victoire, faisant par le retentissement de leurs exploits successifs une immense publicité à l'automobile électrique, d'autres travaillent... et pas seulement du côté des "vaporistes" et des "explosants". Des constructeurs nouveaux de ce véhicule électrique qui paraît vraiment devoir être alors "la voiture de l'avenir", ont fait leur apparition, (Krieger, Mildé, Hautier) et deviennent à leur tour des concurrents redoutables... Gilbert Lecat, le Distributeur Automobile, 1988 |
Première course automobile, Paris-Bordeaux-Paris (1.175 km) ; départ place de l'Etoile le 11.6, départ réel donné sur la place d'Armes de Versailles |
Accident mortel du marquis de Montaignac dans la course de Périgueux. La course de Périgueux fut disputée le 1er mai 1898 sur un parcours d'environ 150 km. Cette compétition est restée célèbre, moins par le résultat sportif enregistré, que pour avoir eu le triste privilège d'être endeuillée par le premier accident mortel de l'histoire des courses. Cet accident fut provoqué par un accrochage entre la Landry et Beyroux du marquis de Montaignac et la Benz "Parisienne" de Montariol. Bien que mourant, Montaignac eut la force de caractère de décrire le déroulement de l'accident, dû à une embardée involontaire au moment où il dépassait la voiture de son ami Montariol en le saluant, et d'en assumer la pleine responsabilité. |
Moteur à l'arrière, généralement moteur De Dion |
Transmission : Une seule roue motrice à l'arrière, l'autre en roue libre (1895-1912) |
Essence de pétrole à 700 degrés, "que l'on trouve chez tous les épiciers, même au village". |
Le Comte De Dion et son associé Bouton réalisent le 1er moteur essence 4 temps 4 cylindres qui tourne à 2000 tr/mn ; Adopté par Louis Renault pour ses premiers véhicules |
Louis Renault invente la prise directe ; brevet en février 1899 |
Michelin est le premier fabricant de pneumatiques au monde à équiper une voiture |
Perceuse Fein : 1er outil électro-portatif mis sur le marché |
Armstrong Electric (Etats-Unis - Bridgeport and New Haven, Conn.) (1895-1931) |
Voitures Audibert, Lavirotte et Cie, "simplicité extrême du mécanisme, légèreté robuste du véhicule" ; voiturtette deux placesn, duc à deux places avec strapontin, duc à quatre places, victoria six places et tramway-car à seize places. ; moteur monocylindre horizontal à deux soupapes fonctionnant à l'essence de pétrole à 700°, transmission par deux courroies, roues en bois munies de bandages pneumatiques ou pleins au choix ; 30 km/h, pentes de 10/12 %, autonomie 200 à 250 km |
Si Cugnot et Trevithick, qui furent les véritables inventeurs - il y a quelque cent ans - des voitures sans chevaux, revenaient parmi nous à la fin de ce siècle, ils seraient étrangement surpris du spectacle qui s’offrirait à leurs yeux. Ils verraient non seulement les avenues de nos grandes villes, mais encore les rues de nos villages sillonnées presque tous les jours par ces véhicules robustes et rapides dont ils avaient rêvé de doter le monde. L’automobilisme, qui n’a guère trouvé sa réalisation pratique qu’en ces dernières années, a marché, on peut le dire, à pas de géant. Et cela à tel point qu’on ne doit même presque plus l’appeler la locomotion de l’avenir, mais plutôt la locomotion du présent. En effet, on compte actuellement plusieurs milliers de personnes possédant au moins une voiture sans chevaux ; les principaux magasins de Paris ont adopté ce système pour la livraison à domicile de leurs marchandises ; demain seront lancés les premiers fiacres automobiles ; et partout, en France comme a l’étranger, la traction mécanique l’emporte au triple point de rue de la rapidité, de l’économie et de la sécurité sur la traction animale. Au nombre des constructeurs qui se sont tout de suite mis à la tête de ce mouvement et qui ont le plus contribué au progrès de l’automobilisme, MM. Audibert, Lavirotte et Cie occupent une place absolument à part. s’inspirant aussi bien du goût et des besoins du public que des derniers perfectionnements apportés dans cette science relativement nouvelle, ils ont créé toute une série de voitures automobiles, répondant aux exigences les plus variées. La supériorité de leurs modèles a pour point de départ les deux principes suivants sur lesquels se sont basés MM. Audibert, Lavirotte et Cie pour l’établissement de leurs voitures automobiles : simplicité extrême du mécanisme, légèreté robuste du véhicule. Le moteur est donc combiné de façon à ce que, sans avoir tout un jeu de tiges ou de leviers à manoeuvrer pour chaque opération, le conducteur paisse mettre la voiture en marche, l'arrêter, en ralentir ou en accélérer l’allure, changer de direction et reculer. On le volt, la multiplicité des mouvements rend le problème très difficile et ce n'est pas le moindre mérite des constructeurs de l’avoir si parfaitement résolu. D‘autre part, on conçoit que le véhicule lui-même, tout en restant léger, doit être extrêmement solide puisqu’il est destiné à rouler aussi bien sur le pavé de bois des villes que sur les routes parfois mal empierrées de la campagne. Du reste, dans l’art de la carrosserie, la robustesse est étroitement liée à l’idée du confort, car qu’y a-t-il de plus désagréable en voiture que d’âtre secoué comme dans un panier à salade ? Or, c’est là un des principaux défauts de certains types d’automobiles, et comme MM. Audibert, Lavirotte et Cie tenaient particulièrement à créer des modèles très confortables, à tous les points de vue, ils n’ont pas manqué de corriger l’inconvénient dont nous parlons en donnant à leurs voitures une assiette qui les soustrait absolument à l’influence des réactions mécaniques et des trépidations fâcheuses. Le moteur breveté et spécialement fabriqué par les ateliers de Montplaisir-les-Lyon, et de St-Chamond, est d'une simplicité remarquable. Il comporte un cylindre et deux soupapes, - pas d’organes, pas d’engrenages compliqués, - par suite l’entretien est réduit au minimum, les chances d’avaries, de rupture en cours de route sont presque nulles. De plus, il fonctionne avec une régularité parfaite : la mise en marche, le ralentissement, l’arrêt s’opérant on quelque sorte instantanément. |
Autre point capital : le moteur étant horizontal se trouve par conséquent disposé dans le même plan que le châssis inférieur de la voiture, d’où équilibre absolu et suppression totale des trépidations, aussi bien au repos qu’aux plus grandes vitesses. La transmission est assurée, non pas au moyen d’engrenages qui, en principe, ont l’inconvénient double d’augmenter inutilement le poids mort du véhicule et de produire un bruit désagréable de ferraille, mais simplement au moyen de deux courroies avec leurs poulies. Système essentiellement ingénieux et pratique. Quant au combustible employé, c’est l’essence de pétrole à 700 degrés, que l'on trouve chez tous les épiciers, même au village. La provision emmagasinée au départ permet de faire, sans être renouvelée, de deux cents à deux cents cinquante kilomètre.. Pour une voiture à six places, la consommation moyenne ne dépasse pas dix litres d’essence par cent kilomètres. La dépense, comme l’on voit, est minime. Sur bonne route plate, la vitesse des automobiles de MM. Audibert, Lavirotte et Cie atteint aisément trente kilomètres à l’heure. Sans aucune fatigue du mécanisme, elles peuvent gravir des rampes de dix à douze pour cent. Dans tous les cas comme à toutes les allures, leur conduite non seulement ne présente aucun danger mais encore est sûre, facile même. D’ailleurs elles sont munies de deux freins extrêmement puissants permettant de modérer la vitesse aux descentes et d’obtenir au besoin, par un énergique blocage des roues, l’arrêt Immédiat. A présent, il convient d’énumérer et de décrire, au moins on quelques lignes, les principaux modèles de voitures automobiles créés par MM. Audibert, Lavirotte et Cie. Nous donnons tout d’abord une gravure représentant un duc à deux places avec strapontin d’une extrême élégance. La garniture intérieure est en drap ou en maroquin, la capote en cuir verni, les roues en bois munies de bandages pneumatiques. Puis nous citerons un confortable duc à quatre places, assez semblable au précédent mais de dimensions plus grandes. Voici maintenant la victoria, construite conformément aux dernières règles de la carrosserie de luxe. A la fois robuste et légère, elle dissimule entièrement son moteur dans la caisse de la voiture et ne présente aux regards que la ligne gracieuse de ses profils. Elle comporte six places. Enfin, nous citons un tramway-car à seize places. C’est encore un véhicule très confortable et très soigné dans tous les détails. Il est pourvu d’un moteur plus puissant, à deux cylindres, et les bandages des roues sont en acier. Mais ce n’est pas tout. MM. Audibert, Lavirotte et Cie ont créé dernièrement un modèle nouveau dont le succès parait assuré, tant à cause de son bon marché que de son élégance pratique. Nous voulons parler de la voiturette à deux places, avec strapontin et porte-bagages. La garniture de drap ou un maroquin est particulièrement soignée. Les roues en bois sont munies de bandages pneumatiques ou pleins au choix. Rien de plus agréable que cette voiturette pour l’amateur et pour l’excursionniste. Citons également les fourgons de livraison, on Insistant sur les services que ce genre de véhicule peut rendre, et rend déjà, au commerce et à l’industrie. En effet, dans les grandes villes, à Paris, à Lyon, à Marseille, où le terrain est si cher, les manufactures vont de préférence s'installer aux environs. Pour d’autres maisons, la clientèle est très dispersée. Aussi, en vue d’assurer le service des transports à la gare, à domicile et souvent même dans la banlieue, il faut une cavalerie nombreuse, qui coûte fort cher. Le fourgon automobile supprime cette cavalerie avec tous ses Inconvénients, et fonctionne sans fatigue et sans grande dépense, nuit et jour, si l’on veut. Tous les prix, bien entendu, peuvent être modifiés suivant le genre de garniture adopté. Ils diminuent dans une assez forte proportion ai l’on remplace les bandages pneumatiques par des bandages on caoutchouc plein, ou en fer ou encore en acier. MM. Audibert, Lavirotte et Cie construisent en outre, sur demande, tous les modèles de voitures de luxe ou de service. C’est ainsi qu’ils ont été récemment amenés à établir un type de fiacres automobiles qui circuleront d’ici peu à Lyon et à Paris, ainsi qu'un modèle de berline fermée pour les longs voyages et un autre modèle de mall-car gracieux, très pratique pour les excursions. Ils se tiennent, du reste, à la disposition des amateurs d’automobilisme pour leur donner tous les renseignements nécessaires sur la conduite, le fonctionnement et l’entretien des voitures construites aux ateliers de Monplaisir-les-Lyon et de Saint-Ghamond. Bien de plus instructif et de plus attrayant qu’une visite aux usines de MM. Audibert, Lavirotte et Cie : on y fait en s’amusant son apprentissage de mécanicien, - et ça n’est pas long " L'Avenir Industriel du Cycle et de l'Automobile, n°1, novembre 1897 |
Tricycle automobile équipé d'un moteur à deux cylindres horizontaux opposés, réalisé par Herbert Austin, travaillant principalement pendant ses heures de loisirs, dans l'usine de la Société Wolseley ; soupapes en tète commandées par un renvoi à engrenages coniques ; un second prototype est construit en décembre 1896, Austin entraînant avec lui la totalité de l'entreprise. |
Pami les plus grands industriels anglais de l'automobile ne le cédant qu'à William R. Morris pour le volume de production, il fut le premier par ses qualités d'ingénieur créateur de moteurs et de voitures légères, et d'organisateur de la production en grande série. Herbert Austin naquit en novembre 1866 à Little Missenden, dans le Buckinghamshire, dans une famille d'agriculteurs qui devait, quelques mois après sa naissance, se transplanter à Wentwerth, dans le Yorkshire. Là, Austin père lut employé comme intendant d'un domaine agricole appartenant au comte Fitzwilliam, Après ses études, le jeune Austin suivit un de ses oncles en Australie, où il lut employé pendant quelques années dans une usine d'étirage de tubes pour adduction d'eau qui appartenait à ce dernier. Avant sa vingtième année, après avoir passé deux ans environ dans une autre entreprise de Melbourne qui importait et installait des machines, Austin fut engagé par la Longlands Foundry Company, une importante entreprise qui, en plus de ce qu'indiquait sa raison sociale, ne s'occupait pas seulement de fonderie mais également de la vente de machines et d'outillages importés d'Angleterre en pièces détachées. Au cours de sa collaboration avec la Longlands, Austin eut l'idée d'un système qui augmentait le rendement d'un modèle de tondeuse à moutons produite dans la mère patrie par Frederick Wolseley. La proposition fut transmise à la Société Wolseley qui l'appliqua, d'une façon générale, à toute sa production de tondeuses. Austin fut d'abord chargé de diriger la succursale australienne, puis appelé ensuite en métropole pour superviser toute la production. En 1895, travaillant principalement pendant ses heures de loisirs, Austin réalisa dans l'usine de la Société Wolseley un tricycle automobile équipé d'un moteur à deux cylindres horizontaux opposés. Si ce véhicule était encore loin d'une configuration proprement automobile, le moteur révélait une conception assez efficace, avec des caractéristiques très en avance pour l'époque, comme, par exemple des soupapes en tète commandées par un renvoi à engrenages coniques. Un second prototype fut construit en décembre 1896. Encore insatisfait des résultats obtenus par ses recherches personnelles, mais désormais absorbé par cette activité, Austin réussit à entraîner avec lui la totalité de l'entreprise. Au cours de l'année 1900, il obtint les moyens nécessaires a la construction d'une voiturette à quatre roues avec laquelle il s'adjugea la première place dans sa catégorie et la seconde, absolue, dans une épreuve d'endurance de 1000 miles mise sur pied par le Royal Automobile Club. Herbert Austin avait pris auparavant rasant envers lui-même l'engagement de cesser toute expérimentation automobile en cas d'échec de son troisième véhicule. La victoire obtenue fut. au contraire, le véritable début de l'industrie automobile en Angleterre, En 1901, l'activité de la Société Wolseley, dans le secteur des moteurs et de l'outillage de précision, fut séparée et cédée à un nouveau groupe financier dans lequel la majorité était entre les mains des frères Vickers. Austin fut nommé directeur général du nouvel ensemble : la Wolseley Tool and Motor Car Company Ltd, dont le siège était à Adderley Park, près de Birmingham. Jusqu'en 1905, il étudia les projets et dirigea la production des voitures à moteur horizontal sur lesquelles fut assise, initialement, la renommée de Wolseley comme marque d'automobile. Puis, par suite de divergences de vues sur les critères de la production, il fut amené à donner sa démission et à devenir chef d'entreprise pour son propre compte. Pendant la période de guerre, il agrandit considérablement ses établissements pour faire face aux besoins en fournitures militaires et se rendit aux Etats-Unis d'où, comme André Citroën, il revint au courant des principes les plus récents de la production à la chaîne. Il se trouva donc prêt à transférer ces techniques dans la fabrication d'automobiles lorsque cessa le conflit. En 1936, il reçut le titre de lord Austin of Longbridge, qui lui conféra le droit de siéger à la Chambre des pairs. Après une brève maladie, Herbert Austin, fondateur et premier président de la Société Austin Motor Ltd, mourut le 23 mai 1941. Dans son bureau la devise suivante resta bien en vue pendant de nombreuses années "La majeure partie de ce qui est valable est née de l'imagination de quelques rêveurs. |
Première automobile de Marius Berliet |
Buffaut et Rebatel (France - Lyon) (1895-1898) |
Canadian Motor Syndicate (Canada) (1895-1899) |
H.H. Carpenter (Etats-Unis - Denver, Colorado) |
Charrondière (France) (1895-1898) |
Tricycles Clément, réalisés avec des moteurs monocylindres De Dion Bouton, entre 1895 et 1897 (Adolphe Clément) |
Né le 22 septembre 1855, Adolphe Clément devint un des plus grands industriels français. Au cours d'une carrière qui comporte tous Les éléments d'une biographie "à l'américaine" : origine modeste, métiers humbles, exercés avec courage dés son plus jeune âge, et intuitions heureuses, qui lui permirent de recueillir tous les bénéfices d'un secteur industriel alors en train de s'affirmer rapidement (celui du cyclisme, de l'automobile et des pneumatiques). D'une certaine manière, les vicissitudes de sa carrière de chef d'entreprise sont analogues à celles d'Alexandre Darracq, avec qui il était lié financièrement. Passionné de cyclisme, qu'il pratiquait avec quelque succès, Adolphe Clément ouvrit à vingt et un ans (à Bordeaux) un atelier de réparation de bicyclettes. De la réparation à la construction, il n'y avait qu'un pas, d'autant plus facile à franchir qu'il pouvait tirer parti des pièces anglaises déjà renommées, et qui étaient en train d'envahir le marché mondial. Après un an de travail comme constructeur à Lyon, où il avait transféré son activité, Clément ouvrit un atelier plus grand, 20, rue Brunel, à Paris, où il anima également une école de cyclisme. Le succès de cette initiative et l'agrandissement continuel de l'usine allaient le mettre en difficulté, par suite de son endettement croissant, lorsqu'il fut amené à acquérir, en 1888, la concession pour la France des tout nouveaux pneumatiques Dunlop. Clément était pourtant réticent, en raison d'une clause du contrat qui l'obligeait a se rendre possesseur d'un nombre important d'actions Dunlop. Le décuplement de la valeur de ces acttions, dont la cotation en bourse monta immédiatement en flèche, fut le début d'une évolution qui apporta une solution a ses problèmes financiers. En 1891, en effet, Adolphe Clément avait pu liquider les divers associés auxquels il était lié dans la première société Clément et Cie, et il avait réinvesti une partie de son capital dans une spéculation foncière heureuse : l'acquisition de très vastes terrains à Levallois-Perret, la future banlieue industrielle de Paris, pour y installer un vélodrome (1893). Il était tellement préoccupé par cette initiative, prise conjointement avec son ami de Civry et son futur gendre, le champion cycliste Fernand Charron, qu'il confia ce dernier la direction de l'établissement du Pré-Saint-Gervais, après avoir accepté la proposition du groupe financier franco-anglais (la partie française étant représentée par Alexandre Darracq) qui détenait le contrôle des fabriques de bicyclettes Humber et Gladiator, de constituer un trust encore plus grand, dans lequel la société Clément serait englobée. Le premier événement automobile qui mit en lumière le nom de Clément date de cette période. Entre 1895 et 1897, quelques tricycles furent réalisés avec des moteurs monocylindres De Dion Bouton. De nouveau, en janvier 1897, et toujours sur projet de l'ingénieur Michaux, deux voiturettes furent construites avec des moteurs 2 cylindres horizontaux, qui pourraient bien avoir été dus à Michaux lui-même. Presque à la même époque, on eut connaissance d'un tricycle Clément-Garrard, tandis que Clément-Gladiator, au Pré-Saint-Gervais, préparait son tour une série de voiturettes, équipées de moteurs monocylindres Aster refroidis par air et avec boîte de vitesses épicycloïdale à deux rapports. |
Ce furent les débuts d'une production diffusée en France et en Angleterre par les deux marques associées ou bien par une seule des deux, suivant les possibilités locales. Avant même que ces courants d'intérêts se soient consolidés, Adolphe Clément prit des participations non seulement dans la société des moteurs Aster mais aussi dans les anciennes usines Panhard et Levassor, doit il acquit la majorité des actions et devint directeur commercial, en même temps que, à la suite de la mort d'Emile Levassor, une réorganisation de la société était effectuée. Cette entreprise, qui se consacra à la construction de voitures de grandes dimensions et à laquelle Clément devait par la suite céder ses parts, concéda au groupe les droits de distribution de la Clément-Panhard, une élégante monocylindre (mais déjà archaïque quand elle arriva sur le marché) qui n'avait de Panhard que le nom. Le développement de L'automobile, déjà une réalité en 1900, décida Clément à renoncer à son vélodrome et à réaliser, sur le même terrain du quai Michelet à Levallois, un nouvel établissement de construction automobile, en s'assurant la collaboration de Marius Barbarou (un des plus grands ingénieurs de l'époque). Dans la courte période de 1901 à 1902, Barbarou établit une gamme de trois modèles une deux cylindres et deux voitures à quatre cylindres toutes avec soupapes d'admission commandées, dont la production Fut entreprise à l'échelle industrielle. C'est de cette époque que datent les importants accords avec la carrosserie Rothschild pour installation d'un département intégré Clément. L'année 1903 fut une année difficile pour Clément, malgré le succès continuel de la production : il perdit Barbarou, engagé par la société Benz. Peu après, il fut mis en demeure par ses propres associés du consortium Clément-Gladiator-Humber (dans lequel, par ailleurs, il ne conservait plus qu'une participation minoritaire) de ne pas continuer à utiliser son propre nom pour sa production automobile indépendante. Cette exigence semblait fondée alors que les nouvelles activités de Clément faisaient une concurrence évidente ce même consortium. A partir de ce moment, les "vraies" Clément, auxquelles il consacrait ses soins quotidiens au quai Michelet, durent cesser de porter son nom. Il choisit la marque Bayard, qui deviendra ensuite Bayard-Clément et, plus tard, Clément Bayard, en raison de la présence d'une statue de ce guerrier fameux dans la cour de son usine de Mézières. Les voitures de la marque Clément et celles de la marque Gladiator continuèrent être construites dans l'établissement du consortium primitif, situé au Pré-Saint-Gervais, attachant au nom de Clément une partie de leur prestige déjà en déclin. De la souche initiale sortirent deux branches anglaises la Clément-Talbot (Talbot) et la Clément-Motor Co Ltd, dont seule la première put se développer et devenir une entreprise industrielle autonome, tandis que la seconde resta une entreprise commerciale. La société Gladiator, qui, elle, avait ouvert une tête de pont pour la fabrication sous licence, continua également son activité en Angleterre uniquement comme entreprise commerciale. Clément connut la même malchance que Bugatti. Il fut affecté par la perte de son fils aîné, tué dans un accident lors de l'essai d'une voiture de course en 1907. En 1914, quand il se retira de la direction de la société Clément-Bayard, il fut remplacé par son autre fils Maurice, jusqu'alors au second plan et qui avait toujours manifesté un intérêt plus vif pour l'aviation que pour l'automobile. Adolphe Clément mourut en 1928, frappé d'une attaque cardiaque au volant d'une voiture, dans le centre de Paris, en se rendant un conseil d'administration. En reconnaissance de son activité, il avait obtenu du Conseil d'Etat l'autorisation d'ajouter son nom le suffixe de Bayard. |
Tricycle Comiot |
Craigievar Express (Postie Lawson - Ecosse - Aberdeen) |
Tricycle Créanche |
Dalifol (France - Paris) (1895-1899) |
Alexandre Darracq (France - Suresnes) (1895-1930) |
Participation d'une Darracq électrique dans la course Paris-Bordeaux-Paris |
Delahaye 2 cylindres moteur arriere tonneau (1895 - 1902) |
Tricycle motorisés de Gérard Dasse à Verviers (Belgique) ; dans les années 20, il se tourne plutôt vers la fabrique d'utilitaire |
De La Vergne (New York Refrigerating Company - Etats-Unis - New York) (1895-1896) |
Debeau (France) (1895-1897) |
Tricycle De Dion Bouton A, B et C à refroidissement par air (culasses et cylindres munis d'ailettes) ; moteur à essence De Dion Bouton 3/4 CV, allumage à haute tension amélioré par bougie électrique (innovation), interrupteur et accumulateur ; De Dion n''était pas satisfait des moteurs Daimler, dont la vitesse n'atteignent que 700 à 900 tours/minute, tandis que sur ses groupes, il obtient jusqu'à 3 000 tours/minute ; dans l'Illustration, premier article sur le Tricycle à pétrole De Dion et Bouton de M. Baudry de Saunier ; plus de 100 utilisateurs, comme Renault, Delage, Phébus, Adler et même Pierce Arrow en Amérique ; le tricycle phaéton De Dion et Bouton participe à la course Paris-Bordeaux-Paris en 1895 puis au raid Pékin-Paris en 1907  |
Doherty (Tom Doherty - Canada - Sarnia, Ontario) |
Duryea (American Automobile industry - Etats-Unis - Springfield) ; Franck Duryea (1895-1898) |
Première automobile américaine Duryea ; moteur 2 cylindres horizontaux placé derrière l'essieu, transmission par chaîne |
Fisson (France - Paris) ; L. Fisson (1895-1906) |
Graf (Autriche - Vienne) ;: voiturette des frères Carl, Franz et Heinrich Graf, propriétaires à Vienne d'un atelier de réparation de bicyclettes ; moteur monocylinde De Dion-Bouton 402 cm3 de 3,5 CV; boîte de vitesses à deux étages, transmission par arbre à cardan et différentiel sur les deux demi-axes avant ; c'est la la première automobile à traction avant au monde |
Hertel (Oakman Motor Vehicvle Company - Etats-Unis) (1895-1900) |
Hurtu - Compagnie des Cycles et Automobiles Hurtu (France - Paris / Rueil) (1895-1934) |
Drojky électrique de Jeantaud  |
De Chaseloup-Laubat sur Jeantaud à la course de côte de Chanteloup ; une pluie torrentielle s'abat sur la course et Chasseloup-Laubat ne peut prendre le départ, ses chaînes sautant à chaque démarrage  |
Voiture Jeantaud dans la course Paris-Bordeaux-Paris : break 6 places, à la belle peinture bleu foncé égayée de filets jaune vif et aux roues de bois clair vernies. Un dais avec rideaux latéraux protègent les voyageurs du soleil ou de la pluie ; fixé transversalement au milieu du châssis, le moteur Rechniewski (de 7 ch et deux fois plus sur de brèves périodes) attaque le différentiel sur un arbre intermédiaire par deux couronnes de démultiplication (ce qui donne deux vitesses étagées dans le rapport de 1 à 2), tandis qu'aux extrémités de cet arbre intermédiaire, deux pignons entraînaient les roues arrière par des chaînes ; ses batteries ne lui autorisant qu'une autonomie de 50 à 75 km à la moyenne de 24 à 30 km/h, il fait installer des postes tous les 40 km, l'échange demandant moins de 10 minutes ; la voiture pesant 2 200 kg, il emmène un mécanicien, un électricien et un carrossier  |
Encouragés par le succès du Paris-Rouen, le Comte De Dion et ses amis avaient décidé d'organiser une course de vitesse - et sur une longue distance - l'année suivante. Ce sera le célèbre "Paris-Bordeaux-Paris", long de 1 200 km, et qui verra parmi les engagés, une très forte majorité d'automobiles à pétrole, quelques voitures à vapeur et une électrique, portant le nom de son constructeur : Jeantaud. Né à Limoges en 1840, d'un père carrossier, Charles Jeantaud fera très tôt son apprentissage à son côté. Tout jeune, il "monte" à Paris, où il travaillera successivement chez Remery-Gauthier, puis chez Plillon (aux Champs Elysées) et enfin, chez Moingeard, que, cadre supérieur, il finira par racheter. Son affaire prospère, et Jeantaud sur sa lancée, rachètera également la maison Ehrler, carrossier de l'empereur... aux Champs Elysées, (son rêve !).. Mais, voilà, comme un virus, Jeantaud a contracté une passion : l'automobile électrique ! Oh ! il a de bonnes raisons pour cela. N'est-ce pas chez lui que Philippart avait amené la Mancelle-Bollée à vapeur pour être transformée en "électrique" par le génial Raffart. Le carrossier, de seize ans plus jeune, voue une admiration sans réserve pour l'ingénieur et rêve de suivre sa voie. Il a déjà bricolé un tilbury à deux places sur lequel a été greffée une vieille machine Gramme alimentée par une vingtaine d'éléments Fulmen, et le tout grillera allègrement à quelques centaines de mètres de ses ateliers. Qu'importe ! Début 1887, il installe sur l'engin un moteur lmmisch, fabriqué en Grande-Bretagne, et cette fois, il arrivera à Courbevoie : accus vidés ! Le moteur sera remplacé par un Thury de Genève et avec 420 kg d'accus Fulmen, parcourra 30 km à 20 km/h de moyenne. Insuffisant toutefois pour l'éliminatoire du Paris-Rouen (50 km en moins de 3 h) et le carrossier-constructeur piétinera jusqu'à la fin de l'année 1894 où, l'annonce du "Paris-Bordeaux-Paris" fixé pour la mi-juin 1895, viendra le galvaniser. Il a moins de six mois devant lui ! Fiévreusement, il conçoit, dessine et réalise une nouvelle voiture qui devra parcourir deux fois 600 km alors que ses essais les plus satisfaisants (et il est alors nettement en avance sur ses concurrents), ne lui autorisent qu'une autonomie de 50 à 75 km à la moyenne de 24 à 30 km/h ! Mais il sait qu'il possède deux atouts : le moteur électrique "tient" mieux que ceux à pétrole, et de plus, une grande partie du trajet s'effectuant de nuit, il disposera d'un meilleur éclairage. Le point faible étant les accus, il luisuffira d'installer des postes tous les 40 km, l'échange des batteries demandant moins de 10 minutes. Et comme la charge n'est pas un handicap pour lui, (sa voiture pesant 2 200 kg) il emmènera trois équipiers musclés : un mécanicien, un électricien et un carrossier... qui lui seront d'ailleurs bien utiles. |
"En tous cas, la Jeantaud apparaît d'emblée comme une des plus élégantes voitures de la course. C'est un superbe break 6 places, à la belle peinture bleu foncé égayée de filets jaune vif et aux roues de bois clair vernies. Un dais avec rideaux latéraux protègent les voyageurs du soleil ou de la pluie. Fixé transversalement au milieu du châssis, le moteur Rechniewski (de 7 ch et deux fois plus sur de brèves périodes) attaquait le différentiel sur un arbre intermédiaire par deux couronnes de démultiplication (ce qui donnait deux vitesses étagées dans le rapport de 1 à 2), tandis qu'aux extrémités de cet arbre intermédiaire, deux pignons entraînaient les roues arrière par des chaînes. Au bout d'un labeur acharné la voiture, est prête à quelques jours du départ, et n'a que le temps d'effectuer Paris-Versailles et retour, soit 35 km ce qui est plutôt faible comme rodage. De plus Jeantaud est soucieux. En arrivant Place de l'Etoile, un piéton dans la lune a traversé sans regarder et en voulant l'éviter, le conducteur a heurté sa roue arrière sur une borne, faussant la fusée... et il y a 1 200 km à parcourir ! Dès les premières descentes, Jeantaud se rend compte que la voiture est freinée d'où perte de vitesse et surcroît de consommation. Peu avant Châteaufort, ce qu'il craignait arrive : le moyeu commence à fumer. Sa graisse bouillante carbonise le beau vernis des rayons de bois clair. Jeantaud laisse rouler le véhicule jusqu'aux premières maisons du village où il sait qu'il trouvera de l'eau. La jante sera refroidie, emplie plusieurs fois de graisse neuve, entourée de chiffons mouillés et les quatre hommes repartent s'arrêtant presque tous les dix kilomètres pour renouveler l'opération... Abandonner ? Jeantaud y a songé un instant mais après le battage publicitaire qu'il a fait, ce serait la fin de son entreprise déjà mise en difficultés par sa folle passion. Une satisfaction cependant. Ce prototype à peine essayé fonctionne fort convenablement, mais Jeantaud avec son expérience pressent qu'il ne pourra arriver au bout en tressautant de la sorte. Tôt ou tard ce sera la casse... définitive. A Etampes, il télégraphie à un carrossier de sa connaissance qui se trouve à Orléans, pour lui demander son assistance, et à minuit, il arrive chez lui où tout est prêt pour l'accueillir. Peu après, l'essieu est déposé, examiné et passé à la forge. Ce sera Jeantaud lui-même qui en bras de chemise, le redressera doucement à la masse, vérifiera, réchauffera, martèlera de nouveau... et recommencera. Lorsque l'opération s'achève, il est plus de 9 heures du matin, et il faudra encore trois heures pour remonter le tout. A midi, prêt à partir, il apprend que Levassor est arrivé à Bordeaux à 25 km/h de moyenne !" |
Que faire ? Jeantaud n'hésite pas, il doit rallier Bordeaux lui aussi, bien que ses compagnons et lui même (qui a 55 ans), soient morts de fatigue... Un repas léger, quelques heures de sommeil et à 20 heures ils repartent dans la nuit. Côté mécanique, la voiture continue de bien tourner. Mais, les vibrations engendrées par la fusée faussée ont mis à mal les paliers de bronze du moyeu qui perd régulièrement sa graisse par des joints qui ne sont plus "étanches" du tout. Jeantaud sait qu'il est bon dernier mais il lui faut sauver l'honneur en ralliant Bordeaux... et il s'y emploie de toutes ses forces. Un changement d'équipage avait été prévu à Châtellerault, mais comme Levassor (qui a presque le même âge), Jeantaud décide de conduire jusqu'au bout, tandis que ses trois compagnons refusent de le laisser partir sans eux. Au fil des kilomètres, il croise ses concurrents plus chanceux qui remontent sur Paris. Levassor bien sûr, mais aussi deux voitures à vapeur, la Serpollet et la Rollée, enfin les frères Michelin en train de changer pour la énième fois un pneumatique. En tous cas, le 25 de Jeantaud arrivera sans peine à Bordeaux où les spectateurs (dont beaucoup voyaient pour la première fois une voiture électrique) lui firent une ovation. Là, Jeantaud annonça que "l'état de sa roue arrière le contraignait à l'abandon". Il n'empêche que sa moyenne générale de 16 km/h, non seulement n'était pas ridicule, mais le classait 7e des temps réalisés. La preuve était faite qu'une voiture électrique - pourvu qu'elle dispose de batteries - avait un fonctionnement sans histoire, se permettant de surcroît de battre nombre de voitures à vapeur ou à pétrole. Même mitigé, le succès de cette démonstration permit à Jeantaud de relancer son affaire... et fort de son expérience, de se plonger dans l'étude de nouvelles voitures, électriques. Ce sera tout d'abord un modèle révolutionnaire : traction avant et moteur en travers... en 1896 ! On voit que Tracta (927), Citroën (1934), puis les réalisateurs de l'Austin britannique d'après la dernière guerre n'avaient rien inventé ! Mais pour la course, Jeantaud reviendra à la disposition du "Paris-Bordeaux" qui a fait ses preuves et reste plus fiable. C'est à cette époque (1896) que Jeantaud fait la connaissance du jeune Comte de Chasseloup-Laubat, sportsman passionné de mécanique et qui a déjà couru sur De Dion Bouton. A une époque où les roues de bois cerclées de fer, avec ou sans bandage de caoutchouc étaient encore les seules utilisées, le Comte croit déjà aux possibilités du pneumatique. Il y convertit Jeantaud, qui lui-même, en fera un adepte de l'électrique, et tous deux deviennent des amis puis des associés. Gilbert Lecat, le Distributeur Automobile, 1988 |
Camille Jenatzy - C.T.A. - Société Générale des Transports Automobiles, système Jenatzy (Belgique / France) ; ingénieur réputé et pilote de grand talent, le "jeune belge fabricant de fiacres électriques assez lents" Camille Jenatzy (1868-1913), dit "le Diable Rouge" à cause de sa Barbe rousse, fait construire, selon ses plans, plusieurs types de voitures, notamment des fiacres électriques, par la Compagnie internationale des transports de Paris ; en 1898, l'un des ses châssis est "hautement" transformé, reçoit 2 moteurs et une légère carrosserie profilée pour s'attaquer au record de vitesse/heure que détient alors le comte de Chasseloup-Laubat ; la "Jamais Contente" est la première voiture à dépasser les 100 km/h (1895-1905) |
Wagonnette de Camille Jenatzy, vainqueur à la course de côte de Chanteloup  |
Kliemt (France - Paris) (1895-1909) |
Tricycle à moteur a essence de Knight, considéré comme le premier moyen de locomotion anglais propulsé par un moteur à explosion |
Lanchester Engine Company (Lanchester brothers - Grande-Bretagne - Birmingham / Coventry) (1895-1903) |
Lanza (Italie - Turin) |
Laurin & Klement (Václav Laurin et Václav Klement - Tchecoslovaquie - Mlada Boleslav) |
James N. Leitch Company (Grande-Bretagne) |
L'Electrique (Belgique - Bruxelles) |
Léon Bollée (France - Paris / Le Mans) ; Léon Bollée, second fils d'Amédée Bollée Père ; usine créée en 1895 et rachetée par Morris en 1922 (1895-1924) |
Voiturette à trois roues Léon Bollée à refroidissement par air (culasses et cylindres munis d'ailettes) |
Linzelu (France) ; Luguet et Kléber (1899-1905) |
Marider (France) (1895-1898) |
Morris & Salom Electrobat (Henry Morris et Pedro Salom - Etats-Unis) ; ils remportent le premier prix de la course du "Time-Herald" (1895-1897) |
Morrison-Sturges (Etats-Unis) |
Mors (France - Paris) ; Emile et Louis Mors ; Mors électrique 1941-1943 (1895-1926) |
Mueller (Etats-Unis - Decatur, Illinois) (1895-1900) |
Nègre & Ruffin - H. Nègre (France - Amiens) (1895-1897) |
Owen (Grande-Bretagne) (1895-1936) |
Panhard à moteur Phénix remplaçant le V2 Daimler ; moteur Phénix à deux cylindres en ligne de Levassor, avec un nouveau type de carburateur; deux version : un 3 HP 1237cm3 (75x140) et 4 HP 1206 cm3 (80x120) |
Emile Levassor termine en tête la course Paris-Bordeaux-Paris sur Panhard-Levassor n°5 2 places à moteur Daimler Phoenix 2 cylindres verticaux, 1206 cm3, 4 ch, 600 kg ; parti de Paris, il arrive à Tours à 20h40 puis à Poitiers à 0h43, mais le mécanicien devant assurer le relais étant encore endormi, du fait de l'avance prise, Levassor doit continuer ; 1.200 km parcourus en 48h 42mn, à la moyenne de 24.469 km/h ; il est suivi de Charles Rigoulot à 6 h mais c'est Koechlin, 3e sur Peugeot 4 places, à 11 h, qui est déclaré vainqueur |
Pennington (ex-Edward Joel Pennington, Great Horseless Carriage Company - Harry J. Lawson - Grande-Bretagne) (1895-1900) |
Break automobile 6 places Peugeot |
Tricycle Phoebus |
Pope Manufacturing Company - Pope-Hartford (Etats-Unis - Hartford, Connecticut) (1895-1898) |
Tricycle Rochet |
Roots & Venables (J.D. Roots - Grande-Bretagne) (1895-1904) |
Sturges Electric Motor Cycles Co (Etats-Unis - Chicago, Illinois) (1895-1901) |
4 places électrique Sturges |
Sweany (Dr F.T. Sweany, Chas. S. Caffrey Company - Etats-Unis - Camden, New Jersey) |
Tissandier (France) (1895-1898) |
Vincke (Belgique) ; Nicolas Vincke présente deux calèches à chevaux motorisées au salon du Cycle de Bruxelles de janvier 1895 ; la société Vincke est, à ses débuts, spécialisées dans la garniture des wagons chemins de fer de luxe ; Vinckle est le premier constructeur d'automobile Belge sans avoir pour autant vendu beaucoup d'unités de son véhicule ; il construit des modèles inspirés des Panhard ; la Vincke-Halcrow est importée en Angleterre en 1903 (1895-1828) |
Whitney M. Wagon Co. (G.E. Whitney - Etats-Unis - Boston Mass.) (1895-1899) |
Wolseley Sheep Shearing Company (Frederick York Wolseley - Grande-Bretagne - Birmingham) |
Yeovil (Grande-Bretagne - Yeovil) (1895-1897) |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1896 |
|---|
Evocation du caravaning par Baudry de Saunier dans le revue du Touring Club |
Moteur Panhard 4 cylindres construit spécialement pour les voitures participant à la course Paris-Marseille-Paris ; Emile Levassor est victime d'un grave accident pendant cette course et meurt des suites de ses blessures ; son poste à la direction technique de l'entreprise fut alors repris par Arthur Krebs, ancien officier et ingénieur militaire, qui perfectionne encore la voiture Phénix, dont la version finale, à moteur quatre cylindres, atteint presque 7 litres de cylindrée (130 x 140 mm) |
Peugeot : Utilisation des tubes du châssis comme refroidisseur (moteur Daimler en V) |
La voiture électrique |
Quand l'aurons-nous, enfin pratique, la voiture électrique qui, du jour où elle marchera, détrônera pétrole, vapeur, air comprimé et toutes sources diverses d'énergie ? Il est bien rare que, chaque semaine, je ne reçoive pas deux ou trois lettres conçues à peu près en ces termes "Je voudrais acheter une voiture automobile, mais le pétrole a contre lui sa mauvaise odeur, les trépidations et des moteurs encore trop compliqués ; la vapeur nécessite des transports de combustible beaucoup trop considérables. Où en sont les moteurs électriques ? Pouvez-vous nous renseigner, vous qui, mieux que personne êtes à même de le faire - ça fait toujours plaisir de s'entendre dire cela - et qui êtes à la source même des informations ?" Parbleu, je le sais très bien, et tous ceux qui s'occupent de l'industrie automobile le savent comme moi le moteur électrique est le moteur rêvé ; mais hélas ! il en reste encore au rêve, et de là à la réalité il y a peut-être loin. Et, cependant, je suis loin d'être de l'avis de ceux qui se plaisent à affirmer que la voiture électrique n'existera jamais. Elle existera et nous la verrons. La question est trop brûlante, les recherches de nos ingénieurs sont trop actives pour que l'Eureka ne soit pas dit un jour ou l'autre.Les Américains ont porté tous leurs efforts vers ce but. Ils ont produit plusieurs véhicules, parmi lesquels "l'Electrobat" de MM. Morris et Salom, qui a remporté le premier prix de la course du "Time-Herald". Mais tout cela est loin, très loin de la perfection, même d'un résultat à peu près pratique. De même, chez nous, la voiture Jeantaud est remisée chez son propriétaire et, de loin en loin, fait quelques sorties, mais d'un court rayon. Nous avons aussi la voiture Bogard, qui est disposée de telle sorte qu'elle peut donner pendant dix heures une vitesse moyenne de 12 kilomètres à l'heure.Est-ce là l'idéal ? Non certes ; mais c'est un avis favorable, un encouragement donné aux chercheurs infatigables qui, un beau matin, trouveront, par un effet du hasard peut-être - car c'est lui qui préside le plus souvent aux grandes découvertes - l'"X" si ardemment convoité.Jusqu'à ce jour c'est à l'accumulation que l'on s'est adressé pour fournir l'énergie l'accumulateur, instrument lourd, coûteux et à durée limitée, beaucoup trop limitée. Les véhicules construits d'après ce principe atteignent des poids relativement fantastiques et demandent à renouveler leur puissance à de très brèves échéances, d'où nécessité d'établir des relais impossibles le plus souvent. Je sais bien que de nouveaux perfectionnements sont apportés journellement aux accumulateurs. Nous avons déjà signalé ici la découverte de M. Jean-Marie Roux, et plus récemment encore la prise d'un nouveau brevet par la Société des accumulateurs Fulmen. Mais, quelque légers qu'ils soient, quelque puissance qu'ils aient sous un volume aussi réduit que l'on peut supposer, je ne crois pas les accumulateurs appelés à résoudre le grand problème. L'accumulateur arrivera toujours à l'épuisement, et s'il ne se trouve à ce moment, à point nommé, une usine capable de lui fournir de nouvelles forces la voiture restera le long du fossé, demandant alors à la traction animale qu'elle veut supplanter, la force nécessaire pour la conduire à la dynamo voisine, au râtelier. Nous aurons la voiture électrique le jour où l'on aura découvert le moyen de produire l'électricité dans le véhicule lui-même, le jour où l'on nous donnera une pile primaire assez puissante. Qui nous donnera cette pile primaire ? Ce sera la fortune pour l'inventeur, en même temps que la révolution radicale dans l'industrie automobile, dans la locomotion et la traction mécanique sur route comme sur rail. Paul Meyan. La France Automobile, Juillet 1896. |
Ader - Société Industrielle des Téléphones-Voitures Automobiles système Ader France (Paris / Levallois-Perret, Seine) ; Clément Ader ; Ader 1 en 1900 ; la Société Industrielle des Téléphones-Voitures Automobiles système Ader devient la Société Ader en 1902 (1896-1907) |
Adolph Saurer AG (Suisse - Arbon) (1896-1918) |
Altham (George J. Altham - Etats-Unis - Fall River, Massachussets) (1896-1899) |
Amédée Bollée Fils (France - Le Mans) ; il a construit sa première voiture en 1885 (1896-1922) |
American Electric Vehicle Co (Etats-Unis - Chicago, Illinois) ; fondée par Clinton Edgar Woods (MIT grad) ; fusionne avec l'Indiana Bicycle Co. en 1898 pour devenir Waverly (1896-1898) |
Andrew Riker (Etats-Unis) (1896-1901) |
Anglo-French Motor Carriage Company (Leon l'Hollier - Grande-Bretagne - Birmingham) (1896-1897) |
Arno (Grande-Bretagne - East Peckam, Kent) |
Arnold Motor Carriage Co. (Grande-Bretagne - East Peckham, Kent) |
Voitures Aster (France - Saint Denis) (1896-1909) |
Augé (France - Levallois-Perret) ; D. Augé (1896-1901) |
Baldwin (Etats-Unis - Providence, Rhode Island) (1896-1899) |
Barbereau et Bergerons (France) (1896-1900) |
Barrows Electric Auto-Buggy Barrows Vehicle Co (Etats-Unis - New York NY / Willimantic CT) ; tricycle électrique à traction avant (1896-1899) |
Beeston (Grande-Bretagne - Nottingham, Coventry, Wolverhampton) |
Belsize (Marshall & Company - Grande-Bretagne - Manchester) (1896-1925) |
Bicycle Company Waverly Plant (ex-Cleveland Automatic, Elmer A. Sperry - Etats-Unis - Indianapolis, Indiana) |
Bogard (France) ; voiture électrique, "disposée de telle sorte qu'elle peut donner pendant dix heures une vitesse moyenne de 12 kilomètres à l'heure" (1894-1900) |
Brewster & Co (Etats-Unis - Long Island City, New York) (1896-1937) |
Britannia (Grande-Bretagne) ; voitures électriques conçues par Vaughan-Sherrin (1896-1899) |
Brouhot (France - Vierzon, Cher) ; fabrication de voitures automobiles non reprise en 1918 ; fabrication de machines agricoles jusqu'en 1960 (1896-1914) |
Chevalier (France) (1896-1900) |
Clediaber - Clement, Gladiator et Humber (Gustave-Adolphe Clement) |
Cleveland Automatic (Elmer A. Sperry, Bicycle Company Waverly Plant - Etats-Unis - Indianapolis, Indiana) |
Columbia & Electric Vehicle Company - Columbia Automobile Company (United State Motor Company - Etats-Unis - Hartford CT / New York) ; 1896-1899, Columbia Motor-Carriage Co, Hartford CT, 1900-1907 Electric Vehicle Company of New York, 1908-1912 United Motor Vehicle Co ; la Columbia and Electric Vehicle Company de Hartford, Connecticut, un des plus grands constructeurs de véhicules électriques des Etats-Unis, faisait partie de l'empire industriel du colonel Albert A. Pope ; cycles, motos Pope 1911-1918, automobiles Pope-Hartford 1903-1914, Pope-Toledo 1903-1909 et Pope-Tribune 1904-1907 ; la marque disparaîtt en 1913 lorsque US Motor Company ferme ses portes ; elle entraîne dans sa chute Courier, Stoddard-Dayton, Brush et Maxwell (1896-1913) |
Coventry Motette (Bollee - Grande-Bretagne - Coventry) (1896-1897) |
Cusset (France - Levallois-Perret) |
Daimler of Coventry (Grande-Bretagne - Alleysley, Coventry) ; H.J. Lawson fonde Daimler England dans le but d'exploiter les brevets déposés par Gottlieb Daimler ; il fusionne avec BSA en 1910, acquière Lanchester en 1931, et est racheté par Jaguar en 1960 |
Premier camion fabriqué par Daimler Motoren Gesellshaft Caanstadt |
Darracq électrique au Salon de Paris ; coupé, siège à l'arrière et au-dessus de la caisse (comme dans un cab) ; vitesse 15 km/h pendant 4 h  |
De Dietrich & Cie (France - Luneville / Niederbronn) (1896-1914) |
Dougill (Alfred Dougill - Grande-Bretagne - Leeds) (1896-1899) |
Dunkley (Grande-Bretagne - Birmingham) (1896-1925) |
Egg & Egli (Rudolg Egg - Suisse) (1896-1898) |
Première voiture d'Henri Ford, 2 cylindres 1700 cm3, 0.75 ch à 350 tr/mn, 30 km/h, 250 kg (20.7.1863-7.4.1947, Dearborn, Michigan) ; premier emploi de mécanicien à Detroit en 1879 ; entre comme ingénieur en chef dans la compagnie d'éclairage de Thomas Edison en 1897 ; Detroit Automobile Company fondée en 1899 et dissoute en 1901 ; Henry Ford Motor Company en 1901 |
Georges-Richard (France - Ivry-Port) ; firme fondée à Paris par les frères Georges et Max Richard ; fabrication de cycles puis d'automobiles (première en 1896) ; Georges Richard s'associe à H. Brasier en 1901 (voitures Richard-Brasier) (1896-1901) |
Georges Richard Poney, voiture extra-légère 3.5 HP |
Goujon (France) (1896-1901) |
Hurst (George Hurst - Grande-Bretagne - Holloway, Londres) (1896-1907) |
Jeantaud à moteur transversal électrique et traction avant |
Kellner (France) |
King (Charles Brady King) (Etats-Unis - Detroit, Michigan / Buffalo) (1896 - 1924) |
Voiturette à quatre roues Knight à l'Exposition d'automobiles au Chrystal Palace de Londres ; monocylindre horizontal d'environ 1 ch à 500 tr/mn ; avec deux personnes a bord, la voiturette est capable d'atteindre la vitesse de 15 km/h ; Knight, qui meurt en 1917, n'entreprendra jamais de production industrielle, mais il contribue grandement à la diffusion de l'automobile en Angleterre en luttant contre les très sévères règles législatives alors en vigueur, qui tendent à restreindre la circulation |
Krebs (commandant Krebs - France) |
La Parisienne (France - Paris) (1896-1905) |
Laspougeas (France) (1896-1898) |
Lebrun (France - Montaigne) (1896-1906) |
Tricycle et Quadricycle Léon Bollée |
Lister (Grande-Bretagne - Keighley, Yorkshire) (1896-1899) |
Löhner (Autriche - Vienne) ; Jacob Löhner, ex-Pygmée, carrossier ; première voiture électrique conçue par le carrossier Jacob Löhner et Ferdinand Porsche en 1898 ; voitures à propulsion mixte produites ensuite ; brevet vendu en 1906 à Emile Jellinek (Mercedes) (1896-1906) |
Voiture à essence du carrossier Jacob Löhner (Autriche) |
Società Miari Guisti (Italie - Padua) ; tricycle du Professor Enrico Bernardi propulsé par un moteur monocylindrique de 624 cm3 qui délivre 2,5 ch à 800 tr/mn en 1896 |
Miesse (Belgique - Bruxelles) Jules Miesse (1896-1926) |
Première voiture à vapeur expérimentale de Jules Miesse, inspirée de la Serpollet ; entrée en production en 1898 |
Offord (Grande-Bretagne - Kensington, Londres) |
Olds (Etats-Unis) (1896-1899) |
Oldsmobile (S.L. Smith, ex-Olds / Ransom Eli Olds, General Motors - Etats-Unis - Detroit, Michigan) (1896 - 2003) |
Opperman (Carl Opperman - Grande-Bretagne - Londres) (1896-1907) |
Orient Express (Joseph Vollmer, ateliers Gaggeneau de T. Bergmann - Allemagne) (1896-1903) |
Panhard premier dans la course Paris-Marseille-Paris ; Emile Levassor, projeté hors de sa voiture à la suite d'une collision avec un chien pendant la course Paris-Marseille-Paris, meurt des suites de ses blessures ; René Panhard transforme la raison sociale en Société des Anciens Etablissements Panhard et Levassor |
Panhard et Levassor types Phenix et Centaure |
Panhard et Levassor Duc 2 places |
Armand Peugeot créé la Société des Automobiles Peugeot ; Eugène conserve la direction des Fils de Peugeot Frères (Fabrications traditionnelles) |
Ponsard-Ansaloni - Brule (France) (1896-1901) |
Prétot (France) ; licence Kühlstein-Vollmer (1896-1899) |
Pygmee (Jacob Löhner - Autriche - Vienne) (1896-1898) |
Riker (Andrew Riker) (Etats-Unis) ; véhicules électriques d'Andrew Riker ; la première Riker à essence est produite en juillet 1901 (1896-1901) |
Rossel (France - Lille) (1896-1899) |
Salisbury (Wilbur S. Salisbury, Horseless Carriage Company - Etats-Unis - Chicago) |
Schmidt (France - Paris) (1896-1898) |
Tenting (M. Tenting - France) (1896-1899) |
Thomson (H. Thomson - Australie) (1896-1905) |
Thorneycroft (Grande-Bretagne) (1896-1913) |
Thrupp & Maberly (Espagne) |
Triouleyre (France) (1896-1898) |
Turcat-Mery (France - Marseille) ; Léon Turcat et Simon Mery (1896-1928) |
Vivinus (Belgique) ; Alexis Vivinus, technicien original, inventeur et pionnier de la motorisation, présente son premier véhicule à Schaerbeek, dans les environs de Bruxelles ; après des débuts à caractère artisanal, l'entreprise atteint une certaine activité productrice grâce au succès rencontré par ses véhicules, petits, simples, efficaces et surtout économiques ; après des débuts à caractère artisanal, l'entreprise atteint une certaine activité productrice grâce au succès rencontré par ses véhicules, petits, simples, efficaces et surtout économiques ; en 1899, la première Vivinus fabriquée de série ; à la suite d'accords commerciaux, il parvient vendre un nombre important de ses voiturettes en Angleterre (New Orleans - Twickenham), en France (Georges Richard - Ivry-Port) et en Allemagne (De Dietrich, futur Lorraine Dietrich - Lunéville et Niederbronn) ; au début du siècle, le constructeur belge entreprend la fabrication de voitures de moyenne cylindrée et présente la 15/18 HP, une 4 cylindres avec transmission par arbre, très bien conçue et soignée dans les détails, mais qui ne rencontre pas le même succès que les petits modèles économiques qui l'ont précédée ; d'autres voitures à quatre cylindres sont présentées et même une 6 cylindres, toutes remarquables par leur robustesse. mais loin du caractère économique qui avait été l'apanage des premières Vivinus ; Vivinus est ingénieur à 100 % et commercial pour le reste ; à la fin de la première décennie du siècle, la situation de l'entreprise devint si précaire que la production est arrêtée en 1912 ; Alexis Vivinus entre chez Minerva chez qui il conçoit une des plus belle voiture de la gamme, la Minerva 40 CV |
Winton M. (Car.) C. Co. (Alexander Winton - Etats-Unis - Cleveland, Ohio) (1896-1924) |
Yakovlev-Freze (Russie - Saint Petersbourg) ; "carrosse sans chevaux" exposée à la Foire Industrielle de Nizhny Novgorod, Russie (28.5-1.10.1896, 9.6-13.10.1896) ; considérée comme la première voiture russe, conception Evgeniy Yakovlev et Pyotr Freze (ateliers à Saint Petersbourg) ; véhicule rudimentaire à deux places, moteur monocylindre 1,5 CV arrière, transmission par courroies (changement de rapport par déplacement manuel sur les paires de poulies de diamètres différents), différentiel, deux arbres de roues, chaînes à dents sur les roues motrices (neige), 300 kg, 20 km/h |
| BdA 2011 |
| L'automobile en 1897 |
|---|
Parution de "l'Auto-Vélo", journal illustré et satirique créé en 1897 et dirigé par Pierre Lafitte et Frantz Reichel) |
M. de Montaignac qui, ayant voulu se découvrir pour saluer un concurrent qu'il dépasse, l'accroche et perd le contrôle de son véhicule dans le Paris-Dieppe ; Justin Landry, associé à G Beyroux a participé vers 1895 aux premières courses auto ; en 1897, il est présent avec 2 à 3 voitures aux principales courses organisées alors ; dans la course de Perigueux, il engage 3 voitures dont celle conduite par le marquis de Montaignac qui se tue lors de cette epreuve ; il se retire au Tréport et y décède en 1934 |
Le Ministre de la Guerre crée une Commission militaire des Automobiles. Les avis de cette Commission seront toujours favorables à l'automobile, à tel point qu'en 1901 le Ministère réglemente l'emploi des automobiles dans les grandes manoeuvres. En septembre 1907, par exemple, lors des grandes manoeuvres du Sud-Ouest, 32 poids lourds sont prêtés par différents constructeurs. Ils représentent 19 marques, ce qui montre bien l'intérêt que les industriels de l'automobile portaient à ce genre de manifestations sur le plan publicitaire. |
Boîtes de vitesses à denture droite (1897-1922) |
Présentation et homologation du premier moteur réalisé par Diesel et la Maschinenfabrik d'Augsburg (future MAN) |
Panhard et Levassor : boîte de vitesses sous carter fermé |
Peugeot monte ses propres moteurs, en remplacement des Daimler-Panhard |
ABAM (Kriéger - France) |
Ailloud-Dumond - Ailloud & Dumond - Automobiles Ailloud (France - Saint Foy les Lyon) ; Claudius Ailloud (1897-1905) |
Amiot-Peneau - l'Avant-Train Amiot et Peneau (France - Asnières, Seine) (1897-1902) |
Une Audibert et Lavirotte 4 HP monocylindrique, pilotée par Pinaud se classe troisième à la moyenne de 29,800 km/h, la course de Périgueux, disputée le 1er mai 1898 sur un parcours d'environ 150 km |
Australis (Australie) (1897-1907) |
Autocar (Etats-Unis - Ardmore) ; marque américaine fondée par Louis S. Clarke, prennant la suite de la Pittsburgh Motor Vehicle ; après quelques années, le siège de la firme fut transféré dans les nouveaux locaux d'Ardmore, où sont encore fabriqués des camions ; première voiture à quatre roues en 1898 ; au début du siècle, Autocar construit des moteurs deux cylindres, toujours avec refroidissement par air ; elle est parmi les premières à adopter, en Amérique, la transmission par chaîne ; la dernière voiture Autocar est présentée en 1910 ; en 1953, la firme est rachetée par la White Motor Company (1897-1953) |
Tricycle expérimental Autocar à moteur monocylindre refroidi par air et différentiel |
Benz Velo Comfortable et Ideal |
Berad (France - Marseille) (1897-1899) |
Bergeon (France) (1897-1898) |
Premier parc de taxi électriques à Londres conçus par Walter C. Bersey, qui fournit aussi Paris ; taxi Bersey testé en 1896 par Scotland Yard. |
Bianchi (Edoardo Bianchi - Italie - Milan) (1897-1955) |
Bird (H. Bird - Etats-Unis - Buffalo, New York) (1897-1898) |
Blimline (Etats-Unis) ; "typical homebuilt piano-box runabout" |
Bonstettin (France) |
Voiture électrique Bouquet |
Bouvier-Dreux (France) |
Bushburry Electric (Star Cycle - Grande-Bretagne - Wolverhampton) |
Carubier (France - Lille) (1897-1902) |
Chenard (Asnières, Seine) ; E. Chenard (1897-1905) |
Clément, deux voiturettes furent construites avec des moteurs 2 cylindres horizontaux en janvier 1897, sur projet de l'ingénieur Michaux |
Cohendet (France - Paris) ; C.R. Goodwin (1897-1914) |
1er véhicule électrique Columbia (Albert A. Pope, Columbia Electric Vehicle Company, Connecticut, USA) |
Crouan (France - Paris) (1897-1905) |
Darracq-Gladiator (France - Paris) (1897-1908) |
Triplette électrique Darracq-Gladiator ; 9 min 54 s sur le 10 km (60.6 km/h) le 3 juin 1897. |
Le moteur électrique, par accumulateurs, a fait sa première apparition au Salon du Cycle dans le luxueux coupé à huit ressorts de M. Darracq. C'est un pas fait vers la locomotion automobile dans les grands centres, en attendant que la découverte d'une pile primaire nous permette des envolées plus grandes. Dans la voiture Darracq, les accumulateurs sont logés à l'avant et à l'arrière de la voiture. Leur poids total est d'environ 400 kilos. L'énergie qu'ils débitent est transformée eu puissance par une dynamo spéciale D, étudiée en vue d'utiliser une batterie d'accumulateurs à couplage invariable pour obtenir, avec des efforts différents, un travail constant. Il fallait donc réaliser un moteur dont la variation de vitesse eût lieu en sens inverse de la variation de l'effort. C'est ce qu'a fait M. Darracq, de sorte qu'avec son moteur, il peut appliquer au démarrage la presque totalité du travail disponible avec une vitesse excessivement faible, et faire avancer ainsi sa voiture sans secousse et sans à-coup. Le frein se fait automatiquement aux descentes, car l'action de la pesanteur a pour effet d'entraîner la dynamo qui, de réceptrice devient génératrice, et refoule alors le courant dans la batterie. Le travail ainsi dépensé réalise le freinage et produit une récupération appréciable. D'ailleurs, un autre frein électrique est à la disposition du conducteur, dont le siège, se trouve à l'arrière de la voiture. Un levier unique lui permet d'obtenir le changement de marche et la mise en action du frein de sûreté / Ce levier peut occuper trois positions : marche en avant, freinage et marche en arrière. La charge de la batterie d'accumulateurs est empruntée à une usine électrique ou à la canalisation urbaine : C'est ce qui explique que l'emploi de cette voiture n'est pratiquement possible que dans les grandes villes. Les essais de M. Darracq lui ont permis d'obtenir sur des routes ordinaires, une allure moyenne de 15 kilomètres à l'heure pendant quatre heures. La voiture pèse, en ordre de marche, 1.000 kilos environ : avec trois personnes à bord, son poids s'élèverait donc à peu près à 1.210 kilos. L'éclairage est fourni par les accumulateurs, qui alimentent quatre lampes de seize bougies, une lampe intérieure, deux lanternes latérales et une forte lanterne projecteur à l'avant. |
Voiturette Decauville : apparition de la démultiplication |
Voiture électrique Doré |
Draulette et Catois (France) |
Ducroiset (France - Grenoble) ; Hercules (1897-1900) |
Earle C Anthony (Etats-Unis - Los Angeles, Californie) |
Electric Motive Power (Etats-Unis) ; taxis Electric Motive Power très répandus à New York ; les premiers à être équipés de roues en acier embouti ; roues avant motrices, arrière directrices, freins sur les roues avant |
Elieson Lamina Accumlator Co Ltd (Grande-Bretagne - Londres) (1897-1901) |
Elliot (Etats-Unis - Oakland, Californie) (1897-1900) |
E.M.P. - Electric Motive Power (Etats-Unis) (1897-1900) |
Erie & Sturges (Etats-Unis - Los Angeles, Californie) |
Eysink (Eysink frères - Pays-Bas) (1897-1920) |
Farnell (Albert farnell - Grande-Bretagne - Bradford, Yorkshire) (1897-1905) |
Voiture électrique Garon |
Premières voitures Gautier-Wehrle à moteur à explosion, dotées d'un moteur à deux cylindres horizontaux opposés placé en position centrale sous le châssis, carrossées en cab, en landau et en phaéton (Société continentale d'automobiles) |
Germain (Belgique - Monceau sur Sambre) ; automobile Germain, dite la "Daimler belge" (licence Panhard et Levassor) |
Auparavant producteur de matériel de chemin de fer et de tramway, Les ateliers Germain de Monceau-sur-Sambre furent les premiers en Belgique à atteindre de volumes industriels en matière de production automobile, ce sous licence Panhard et Levassor. Il construit la Daimler belge sous licence en 1897. C'est pour cette raison qu'ils contestent le titre accordé à Vivinus de première voiture de l'ère automobile Belge : Germain bénéficiait des 1898 (contre 1899 pour Vivinus) de l'exclusivité pour la Belgique de la licence des voitures françaises Panhard et Levassor dont ils parvinrent à faire sortir une quinzaine d'exemplaires par mois. Voitures de type Panhard amélioré à partir de 1901. La Germain Standard sort en 1903, 2917 cm3 18 HP (cylindres séparés, transmission par chaîne), suivit d'évolutions en 3810, 5734 et 9811 cm3. La gamme se diversifia ensuite et Germain fut sans doute le premier constructeur à atteindre en 1904 le cap des 1000 véhicules produit. Le plus grand des succès commerciaux fur le Chainless de 1905, 28 HP, culasse en T, radiateur ovale et transmission par arbre, la chaîne de transmission étant remplacée par un cardan. En 1907, 6 cylindres 3834 cm3 (vilebrequin sur roulements à billes). Modèles 6 cylindres 60 HP 8 822 cm3 et 4 cylindres 80 HP 12 454 cm3 ! En 1912, modèle 15 HP à ACT et graissage sous pression et modèle 20 HP à moteur Knight sans soupapes. Alors qu'ils produisent dès les débuts (1898), ils ne reprennent pas la production après 1914. Effectivement, après la guerre, Germain retourne à un secteur de production où ils est sûr d'avoir toutes ses chances : le matériel ferroviaire et les compresseurs... Germain cesse définitivement ses activités en 1967. |
Gladiator (France - Paris-Pre Saint Gervais) ; fondée par Alexandre Darracq en 1897 ; vendue à Adolphe Clément en 1905 puis absorbée par Vinot-Deguingand en 1909 ; licence cédée au groupe anglais British Commercial Syndicate Ltd (Lord Shrewsbury and Talbot) ; intégrée au groupe Sunbeam-Talbot-Darracq en 1919 devenu Talbot à Suresnes (1896-1920) |
Dans les dernières années du XIXe siècle l'histoire de l'automobilisme commence en France avec la fondation d'un nombre important d'usines automobiles. Les premières firmes furent Berliet, Darracq, Decauville, De Dietrich, Mors et autres. Alexandre Darracq créa sa société en 1897 à Suresnes. Ses voitures jouèrent un rôle important dans la fondation de nouvelles firmes automobiles avec des succursales en Grande-Bretagne, en Italie et en Allemagne. Les frères Opel s'inscrivent parmi les premiers fabricants allemands avec la "Opel-Darracq", sous licence française. |
Gladiator-Pingaud (Grande-Bretagne) ; tandem électrique ; en février 1897, 1 kilomètre parcouru en 1 mn 46 s (34 km/h), 5 miles en 8 mn 56 s (54 km/h) ; Edmond de Parrodi le chronomètre à 57 s sur le kilomètre (63.2 km/h) au Vélodrome de la Seine, à Paris, en mai 1897 (1897-1898) |
Gräf (Karl, Franz et Heinrich Gräf - Autriche) |
Grivel (France) |
Guédon et Cornilleau (France - Bordeaux) ; quadricycle à moteur De Dion commercialisé par Decauville (1897-1900) |
Headland Patent Electric Storage Battery Co Ltd (Grande-Bretagne - Londres) (1897-1901) |
J.J. Heilmann (France - Le Havre) (1897-1900) |
Hercules (Ducroiset - France / Grande-Bretagne - Grenoble) (1897-1900) |
Holcar (Michael Holroyd-Smith - Grande-Bretagne) (1897-1905) |
Voiture électrique Hommars |
Hudlass (Felix Hudlass - Grande-Bretagne) (1897-1902) |
Hugot (France) (1897-1905) |
Hurst & Lloyd - Hurst & Plaister (Lloyd et Hurst puis Plaister - Grande-Bretagne - Wood Green, Londres) (1897-1900) |
Illinois Electric Vehicle Co (Etats-Unis - Chicago, illinois) (1897-1901) |
Impétus (France - Pornichet-Plage, Loire Inferieure) ; Max Hertel (1897-1900) |
Justus B Entz - Electric Storage Battery (Etats-Unis - Philadelphie) ; prototype Columbia Mk IX par la Pope Manufacturing Company |
Juzan (France) |
Louis Kriéger - Compagnie Parisienne des Voitures Electriques (procédé Kriéger - France - Paris) ; les ateliers Krieger dominent la catégorie des véhicules à 4 places au Concours de fiacres parisiens.en 1897 (1897-1909) |
Les ateliers Krieger connurent le succès au lendemain du Concours de fiacres parisiens, en 1897, où ils dominèrent la catégorie des véhicules à 4 places. Par la suite. cette firme se fit connaître par de nombreux véhicules électriques, ainsi que des engins mixtes pétroléo-électriques. Le nom de Krieger redevint d'actualité sous l'occupation allemande 1940/44, ayant réalisé de très intéressantes transformations de voitures thermiques ou électriques (modèles Milde-Krieger). 2 moteurs électriques, à excitation combinable, alimentés par batterie 80 volts. 75A. soit 6 kW (2 x 4 chevaux à 2 000 t/mn, maxi 2 200 t/mn). Roues avant motrices, avec moteurs montés sur les pivots, attaque directe. Combinateur à couplage série et parallèle procurant 6 allures de marche. Pas de boîte de vitesse ni d'embrayage, marche arrière par inverseur. Suspensions avant et arrière par ressorts semi-elliptiques. Direction à boîtier démultiplicateur, système Krieger, groupant les contrôles. Freins avant par récupération sur les moteurs, arrière mécaniques sur roues. Roues Artillerie, rayons bois, avec pneus 880 x 120. Longueur 4,20 m, largeur 1,82 m, empattement 2,92 m, voies 1,42 m, poids 1950 kg environ (avec batteries), 35 km/h, autonomie 80 à 95 km. |
Koch (France) (1897-1901) |
Lacoste & Battman (France - Levallois) (1897-1913) |
Leo (Leon Lefèbvre - France) (1897-1898) |
Lloyd & Plaister - ex-Hurst & Lloyd (Lloyd et Hurst puis Plaister - Grande-Bretagne - Wood Green, Londres) (1897-1900) |
Lutier (France) |
Lutzmann (Friederich Lutzmann - Allemagne - Dresden) (1897-1898) |
Lux (Luxwerke Akt. Ges. - Allemagne - Ludwigshafen am Rhein) (1897-1902) |
Madelvic Motor Carriage Co Ltd (Ecosse - Granton, Edimbourg) ; voitures électriques ; les véhicules se révélèrent inutilisable et provoquèrent la perte de la firme (1897-1900) |
Maison Parisienne (France) ; M. Laboure, ingénieur Serex (1897-1900) |
Malverna (T.C. Santler - Grande-Bretagne - Malvern Links, Worcs) (1897-1913) |
Martini (Suisse - Saint Blaise / Frauenfeld) (1897-1934) |
McCabe-Bierman Wagon Company (Paul H. Bierman, Edward J. Powers - Etats-Unis - St. Louis, Missouri) |
Menon (Italie - Trevise) (1897-1903) |
Mercury (Etats-Unis) |
Voiture électrique Mildé |
Millet (Félix Millet - France - Persan, Val-d'Oise) |
M.M.C. - Motor Manufacturing Company (H.J. Lawson - Grande-Bretagne - Coventry) (1897-1908) |
The Mo-Car Synd. Ltd. (Ecosse - Underwood, Paisley / Bluevale, Camlachie, Glasgow) ; société écossaise de construction d'automobiles fondée par Sir William Arrol et George Johnston en 1897 devenue la New Arrol-Johnston Car Co. Ltd en 1905 |
"Société écossaise de construction d'automobiles fondée en 1897 par Sir William Arrol et George Johnston sous la dénomination de Mo-Car Syndicate Ltd. Les premiers véhicules produits étaient du type dog-cart à moteur arrière monocylindrique de 5,5 ch remplacé peu après par un bicylindre de 10 ch. Ces deux moteurs avaient pour caractéristique originale des pistons opposés. En 1905, la société modifia sa raison sociale et devint la New Arrol-Johnston Car Co. Ltd. J.S. Napier fut engagé comme ingénieur en chef. Les capacités indiscutables de ce dernier contribuèrent à l'affirmation des voitures écossaises aussi bien dans le domaine commercial que sportif. Le même Napier, au volant d'une Arrol.lohnston de sa conception, à moteur avant à pistons opposés de 18 ch s'adjugea le Tourist Trophy en 1905. En 1909, année durant laquelle la direction de la société passa aux mains de T.C. Pullinger, la production s'enrichit d'un nouveau modèle, peut-être le plus fameux, équipé d'un moteur de 2,5 I. Taxé en Grande-Bretagne pour 15,9 CV et muni de freins sur les roues avant (solution d'avant-garde abandonnée en 1911 parce qu'apparaissant alors non-fonctionnelle). Cette même année sortirent la 11,9 HP à 6 cylindres et la 23,9 HP à 4 cylindres. La firme Arrol-Johnston expérimenta également une voiture munie d'un moteur essence et d'une transmission électrique aux roues, et un véhicule à propulsion entièrement électrique. Après les années obscures de la Première Guerre mondiale, Arrol-Johnston reprit son activité normale mais abandonna les anciens modèles pour lancer la Victory, conçue par G.W.A. Brown, avec un moteur à arbre à cames en tête d'une cylindrée de 2651 cm3 et d'une puissance effective de 49 ch. Mais son prix élevé découragea les acheteurs. Pour essayer de remonter la pente, la firme remit sur le marché le modèle d'avant-guerre de 2,5 I judicieusement simplifié et qui resta en production jusqu'en 1926. En 1927, Arrol-Johnston fusionna avec la firme Aster, de Londres, renommée pour ses fabrications de moteurs et d'automobiles, Malgré la fusion, les deux entreprises continuèrent à produire chacune ses propres modèles, auxquels s'ajoutèrent par la suite de nouveaux types caractérisés par l'appellation Arrol-Aster. Parmi ces derniers, mentionnons la 17/50, à distribution sans soupapes par fourreau louvoyant, et la 21/60 à soupapes en tète (ancien modèle Aster remis sur le marché sous la nouvelle dénomination). Mais plus la gamme des modèles augmentait plus la firme plongeait dans le chaos. Une tentative de réorganisation fut faite en 1929, misant tout sur un seul modèle, la 23/70 à moteur 8 cylindres de 3 293 cm3, dont une version à compresseur était également proposée. Victimes eux aussi de la crise, les établissements Arrol Aster fermèrent leurs portes en 1930, laissant inutilisée une grande usine toute neuve. " |
Dog-cart à moteur arrière monocylindrique à pistons opposés de 5,5 ch Mo-Car ; moteur remplacé ensuite par un bicylindre, toujours à pistons opposés, de 10 ch |
Montauban-Marchandier (France - Saint Quentin) (1897-1900) |
Montier & Gillet (France) |
Morel et Gérard (France) |
Mytholm Cycle Works (Grande-Bretagne - Hupperholme, Halifax) (1897-1898) |
Neale |
N.W. (Allemagne) |
Adam Opel créé sa première voiture |
Véhicules électriques à traction avant et arrière de Carl Opperman (Clerkenwell, GB) |
Peugeot Type 14, première voiture 100% Peugeot (châssis et moteur) ; moteur 2 cylindres horizontaux arrière (1897 - 1902) |
Plass (Reuben Plass - Etats-Unis) |
Paul Pouchain (France - Armentières) ; voiture électrique (1897-1901) |
Prezident / Nesselsdorf - Koprivnice Nesselsdorfer Wagonbaufabrik (Moravie / Tchécoslovaquie - Koprivnice) ; en 1897, sous l'ancienne monarchie d'Autriche-Hongrie, sur le territoire de ce qui va devenir la Tchécoslovaquie, commence la fabrication d'automobiles ; par l'intermédiaire d'un fabricant de tissus, Théodore von Liebieg, l'usine d'automobiles Koprivnice Nesselsdorfer Wagonbaufabrik en Moravie, se procure en 1896 une voiture monocyl¡ndre et un moteur bicylindrique ; elle permet la réalisation d'une voiture appelée Prezident ; après la Première Guerre mondiale, dans les Hautes Tatras, les moteurs du type U, puissance motrice de 65 CV sont testés ; après ces bilans excellents, la firme de Koptivnice se mue en Tatra (1897-1923) |
Voiture Prezident, de la Koprivnice Nesselsdorfer Wagonbaufabrik ; moteur Benz bicylindre plat de 2,75 litres, 7 ch à 600 tours-minute ; en 1898, la Prezident effectue le trajet de Koptivnice à Vienne, où elle est exposée avec succès, à la vitesse moyenne de 22,6 km/h |
Rhéda (France - Saint Cloud) (1897-1898) |
Voiture électrique Richard |
C. E. Roberts (Chicago Steel Screw Co - Etats-Unis - Chicago) |
Schaudel (France - Bordeaux) ; Charles Schaudel, ancien armurier, créateur de Motobloc en 1902 (1897-1902) |
Simpson (John Simpson - Ecosse) (1897-1904) |
Société Continentale d'Automobiles (France) ; ex-Gautier-Wehrle ; elle construit les premières voitures à moteur à explosion ; dotées d'un moteur à deux cylindres horizontaux opposés placé en position centrale sous le châssis, elles sont carrossées en cab, en landau et en phaéton ; en 1898. la marque se lance dans la fabrication de bicyclettes et de tricycles à essence et produisit un véhicule électrique, un dog-cart très léger pourvu d'accumulateurs au plomb. (1897-1904) |
Stanley Motor Carriage Company (F.E. et F.O. Stanley - Etats-Unis - Newton) (1897-1917) |
Star Engineering Company (Edward Lisle - Grande-Bretagne - Wolverhampton) (1897-1932) |
Stirling (Angletere - Hamilton, Lamarkshire) (1897-1903) |
Stoewer (Emil et Bernhard Stoewer - Allemagne - Stettin (Pologne)) (1897-1944) |
Tarrant (colonel H. Tarrant - Australie) (1897-1907) |
The Autocar (ex-Pittsburgh - Etats-Unis - Swissvale / Ardmore, Pennsylvanie) (1897-1916) |
Toward & Philipson (Grande-Bretagne) |
Troika - Auge - Cyclope (France) (1897-1901) |
Vabis (Suède - Sodertäalje) ; l'usine AB Vabis, fondée en 1891 par Philipe Wersen et Peter Petersson fabrique des wagons de chemin de fer; marque Vabis déposée en 1906; fusion avec Scania en mars 1911 (AB Scania- Vabis) (1897-1911) |
Vabis, automobile à moteur bicylindre deux temps avec tube d'allumage d'August Erikson |
Wilford (Belgique) ; vvoiture rapide Wilford (96 km/h en 1899) à moteur monocylindre à huile lourde (1897-1901) |
| BdA 2011 |